Première partie Deuxième partie Troisième partie
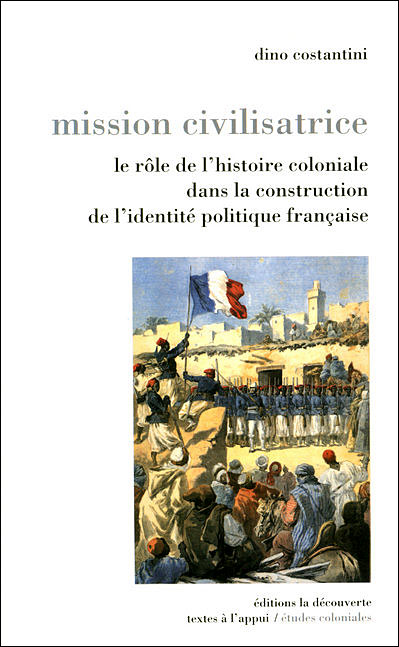
La juxtaposition de populations différentes est – par exemple selon René Maunier – considérée comme le fait fondamental de la colonisation contemporaine :
« Les anciens occupants, les nouveaux habitants ; les dominés, les dominants, les gouvernés, les gouvernants, les tyrannisés, les tyrannisants, comme on dit parfois. Deux groupements, deux corps sociaux, qui sont appelés à coexister, et à suivre donc, par l’effet du temps, un ordre commun, un progrès commun. C’est là le fait social, disons le fait humain qui constitue la colonisation [1]. »
Georges Hardy souligne le fait que cette juxtaposition est en même temps une opposition :
« La colonisation juxtapose et, bon gré mal gré, oppose deux sociétés, deux civilisations, deux conceptions de l’existence en général fort différentes [2]. »
Une situation de type colonial se crée lorsque des populations dotées de conceptions différentes de l’existence, qui ne peuvent donc pas être immédiatement intégrées ensemble dans un tissu national unique, entrent en contact. La colonisation est ainsi comprise comme une relation binaire unissant et séparant à la fois deux populations jugées différentes, les colonisateurs et les colonisés. Pour René Maunier, cette différence se maintient dans toute situation coloniale et représente l’une de ses caractéristiques les plus significatives :
« Il y a donc toujours en pays colonial, deux sociétés vivant sous un ordre commun, qui restent distinguées, et restent séparées, du moins autant qu’on peut ; et qui pourtant, bon gré, mal gré, ont des pouvoirs communs et des devoirs communs [3]. »
La relation entre ces différentes populations soumises à un pouvoir commun est conçue dans les termes d’une relation explicitement hiérarchique :
« Deux groupes inégaux, superposés, hiérarchisés, puisqu’il y a, jusque aujourd’hui, au point de vue du droit, un groupe supérieur et un groupe inférieur, un groupe dominant, un groupe dominé ; et nous dirions aussi légiférant, légiféré, administrant, administré ; mais deux groupes régis par un pouvoir commun, ayant un droit commun, et un progrès commun. La société demeure cependant subdivisée ; les deux groupements demeurent distincts ; s’ils ont des rapports, même au sens du droit, ainsi que nous dirions, ce sont des rapports entre non-pareils, et non pas du tout entre pareils : entre dissemblables et entre inégaux [4]. »
La colonisation unit ces populations dans l’obéissance à un pouvoir commun et les sépare par la production de statuts différentiels. Mais comment une semblable affirmation peut-elle cohabiter avec la méfiance envers les « communautés », typique de la pensée républicaine ? De quelle façon les populations peuvent-elles être distinctes et hiérarchisées sans offenser la tradition révolutionnaire, construite sur la déclaration de l’unité du genre humain et de l’égalité de droit de tous ses membres ?
Pour demeurer en cohésion avec cela, la pensée coloniale ne peut abandonner le présupposé de l’unité du genre humain. Cela signifie que la différence entre colonisateur et colonisé ne peut être rattachée à un état de nature, et donc éternisée, comme le permettrait le postulat d’une infériorité raciale. Penser à la différence des populations colonisées comme à une différence racialement déterminée – naturelle et définitive – signifierait retomber dans la logique de la distinction des couleurs et rendrait impossible l’objectif déclaré de la colonisation, la civilisation du monde.
Le nouveau discours colonial doit donc réaffirmer l’unité de l’espèce humaine, c’est-à-dire le caractère universellement civilisable des êtres humains. D’autre part, comme nous l’avons vu, l’existence de peuples dotés de valeurs différentielles doit être posée pour que soit créée la situation coloniale. Le nouveau discours colonial a donc besoin de penser à la fois l’unité (tendancielle) du genre humain et l’existence d’un différentiel entre les populations qui la composent. Ce différentiel ne peut être conçu comme éternel, mais comme suffisamment durable, toutefois, pour que l’action coloniale trouve un sens et une stabilité.
La pensée coloniale de l’époque ne pose donc pas à l’origine de la situation coloniale une question raciale, un déterminisme biologique, une différence d’essence entre les populations colonisatrices et colonisées. Mais elle s’appuie sur une reconnaissance préliminaire et pragmatique du décalage des situations de départ. La description pittoresque du colonisé donnée par Albert Sarraut nous permet d’appréhender le pragmatisme particulier de la pensée coloniale :
« L’indigène, surtout en pays noir, est en général paresseux, indolent, imprévoyant. Il aime à bavarder ici sous le banian, là sous le baobab, à chanter, à danser, à fumer, à dormir surtout. [5] »
La différence que représente le non-civilisé – sa paresse proverbiale, son indolence, son incapacité à organiser rationnellement sa propre existence – n’est pas imputable à la couleur de sa peau, mais à un ensemble de conditions spécifiques :
« une longue hérédité, le climat, la sous-alimentation [6] ».
Partant de raisons de type socioculturel et non biologique, la différence qui sépare les populations civilisées de celles qui ne le sont pas est par principe temporaire et remédiable, rendant plausible l’idée de la « mission civilisatrice ».
Et pourtant, même en se fondant sur des explications culturelles, la différence entre colonisateurs et colonisés n’en apparaît pas moins profonde. Selon Albert Sarraut, elle trouve son expression la plus caractéristique dans les « tares morales » typiques des populations colonisées – paresse, dissimulation, improbité, absence de conscience –, qui, bien qu’elles puissent être « d’une gravité inégale suivant les races et les individus », apparaissent en général « profondément ancrées dans le tempérament [7] ».
Les tares que l’attachement à leur culture d’origine produit chez les indigènes comme un précipité moral multiplient les difficultés de la colonisation-civilisation. L’habitude de l’incivilité semble produire une corruption atteignant la nature même des populations colonisées, au point de les empêcher de sortir de la barbarie par l’apprentissage. La différence entre civilisés et non-civilisés est d’ordre culturel, mais l’évocation de la culture des seconds s’apparente à la description d’un état de nature, réglé selon une loi éternelle et immuable et faisant des non-civilisés des êtres naturellement immoraux, imparfaits, incapables de réflexion, de conscience ou d’honnêteté.
Cette description ambiguë du colonisé s’illustre, par exemple, dans le pamphlet à succès de Raoul Allier, Le Non-Civilisé et nous. Différence irréductible ou identité foncière ? (1927). Raoul Allier y met en discussion la thèse républicaine issue des Lumières selon laquelle la différence entre civilisés et non-civilisés peut être comblée par l’éducation et ne compromet pas l’unité du genre humain. Pour lui, affirmer l’identité de tous les hommes est un « aphorisme banal » :
« L’humanité n’est pas un corps simple et ne peut pas être traitée comme telle. […] Dans la réalité, on est plus ou moins homme, plus ou moins fils de Dieu. On a de Dieu et de la Vérité ce dont on est capable et ce qu’on mérite [8]. »
Selon lui, l’unité foncière du genre humain, au-delà des différences produites par l’appartenance à une société particulière, a été affirmée sur la base de compte-rendus de voyage tout à fait dépourvus de systématicité. Pour Raoul Allier, les affirmations de Fontenelle, d’Helvétius, de Hume ou de Buffon ont en réalité comme seul horizon le monde européen et civilisé. L’idéalisation du bon sauvage, dont la tradition remonte à Montaigne, et qui trouve dans l’Origine de l’inégalité de Rousseau sa formulation la plus accomplie, lui semble être le prétexte à une critique de la société européenne plutôt qu’une description faite dans les règles de la science.
L’idée de la pureté de la condition naturelle, qui n’a jamais cessé de caractériser le sauvage, se fonde sur une erreur psychologique, liée à un certain esprit missionnaire, qui contribue à diffuser à la fois l’idée du sauvage honnête, pur et juste, et la croyance privée de sens critique en l’unité du genre humain. Mais aux philosophes du XVIIIe siècle manquait l’expérience dont un homme du XXe siècle comme Raoul Allier peut se vanter et qui contraint à remettre en discussion la thèse issue des Lumières à partir des résultats de l’anthropologie et de l’expérience coloniale.
L’anthropologie est invoquée par Raoul Allier comme capable de fournir, contrairement à l’approche tendanciellement idéologique des philosophes des Lumières, un point de vue scientifique sur la question. À ce sujet, les études de Lucien Lévy-Bruhl sur la mentalité primitive sont décisives. Elles soutiennent avec force la thèse de la radicale hétérogénéité entre mentalité civilisée et mentalité primitive, cette dernière se distinguant par son indifférence face à la contradiction, par son caractère prélogique et mystique.
L’expérience coloniale fournit selon Raoul Allier une confirmation significative des thèses développées par Lucien Lévy-Bruhl. Les populations colonisées se distinguent par une « inaptitude prodigieuse à l’attention » et une « inaptitude déconcertante au raisonnement logique », qui empêchent tout effort éducatif d’agir efficacement. L’incivilité, sa pratique millénaire par des sociétés par définition privées de tout dynamisme, finit par imprégner le corps lui-même des non-civilisés, conditionnant leur moralité et orientant profondément leur vie et leurs actions. L’habitude de la barbarie se sédimente dans les corps, ordonnant et gouvernant toute perception, tout souvenir, tout jugement, tout raisonnement :
« La cristallisation de sentiments que l’être porte en lui-même sans en convenir, sans le confesser à lui-même, crée un despotisme d’autant plus brutal qu’il est moins reconnu. Elle crée un prisme à travers lequel la réalité n’apparaît plus que déformée, et qui suggère des excuses supposées décisives pour les abdications les plus hypocrites, pour les paresses les plus honteuses, pour les lâchetés les plus avilissantes [9]. »
Inconsciemment conditionnée par les habitudes d’une société incivile, la mentalité du non-civilisé semble « cristallisée », incorrigible. La culture particulière à laquelle les populations colonisées appartiennent corrompt les capacités intellectuelles et donc celles d’apprentissage, empêchant ainsi toute possibilité d’en sortir. Le non-civilisé vit donc dans une condition définie par Raoul Allier comme une « vraie désagrégation spirituelle » :
« Cette désagrégation, dont les origines remontent à des dates incalculables et qui est faite essentiellement d’abdication presque machinale devant le fait, d’une passivité à peu près radicale devant les événements moraux qui constituent la vie intérieure, d’une absence complète d’initiative, est la cause profonde de cette ankylose intellectuelle et morale qui a rivé chacune de ces peuplades aux stades qu’elle n’a jamais pu dépasser [10]. »
L’ankylose créée par l’habitude de l’incivilité enferme les non-civilisés dans leur condition d’infériorité. Passifs par définition et ne possédant aucun esprit d’initiative, ceux-ci demeureraient, sans la providentielle intervention d’une nation évoluée, enfermés dans le cercle de leur barbarie, destinés à le parcourir éternellement : « depuis des millénaires, [ils] sont esclaves d’une mentalité déterminée qui les empêche de monter plus haut [11] ».
Raoul Allier cite Hermann Dieterlen, qui, dans le Journal des missions évangéliques, se prête à une confirmation bien informée des thèses sur l’hétérogénéité formulées par L. Lévy-Bruhl :
« Nous, les Européens, gens de réflexion et de raison, nous éprouvons un besoin irrésistible de tout comprendre, d’être logiques, de tout réduire en système, d’écarter toute contradiction dans nos idées et dans nos croyances. Et nous procédons de la même manière quand nous cherchons à comprendre et à expliquer les notions religieuses – ou soi disant telles – des nègres. Nous échouons : quoi d’étonnant ? Le nègre se contente d’idées plus vagues et ne se laisse pas incommoder par les contradictions flagrantes qui s’y trouvent. Il ne précise pas, il ne raisonne pas, il n’a pas de logique : il n’y regarde pas de si près […] ces nègres n’ont pas de théories. Ils n’ont même pas de convictions, ils n’ont que des habitudes, des traditions [12]. »
Les non-civilisés ne possèdent ni logique ni pensée, n’ont aucune idée qui ne soit vague et contradictoire. Comme ils ne sont pas logiques, n’éprouvent aucun besoin d’ordonner leurs connaissances dans un système et se montrent incapables de transcender les faits sur le plan constructif de la théorie, leur vie se déroule éternellement identique à elle-même dans le cercle fermé de l’habitude et de la tradition. L’incapacité à s’améliorer par l’apprentissage, marquant l’immobilité absolue des cultures non civilisées, est une particularité qui, insiste R. Allier, a étonné des générations de colonisateurs et de missionnaires, lesquels, à partir des allégations très théoriques des Lumières, s’étaient préparés à les mener à la raison, à combler leur retard par une patiente œuvre d’éducation.
L’expérience coloniale démontrerait donc le caractère largement idéologique de la pensée des Lumières et le caractère théorique de l’affirmation de l’unité essentielle de l’espèce humaine. La pratique coloniale et l’échec auquel conduisent invariablement les tentatives de civilisation imposent à toute réflexion future sur le statut des non-civilisés de « poser comme un fait qu’ils sont peu disposés à la réflexion, au raisonnement abstrait, en un mot à l’effort intellectuel [13] ».
Toutefois, si l’imperméabilité des non-civilisés à l’éducation devait se révéler complète, si la différence était véritablement immuable, la principale ambition des civilisateurs, le but même de la colonisation – faire entrer à l’intérieur de la famille humaine ses fils dits attardés, conduire les populations prétendument arriérées le long du chemin de la raison et de la civilisation –, ne pourrait être atteinte.
Dans le fil de ce raisonnement, Raoul Allier, après avoir douté un moment de la légitimité de l’ambition civilisatrice, rappelle comme elle a de tout temps été utile aux conquistadores pour justifier leurs entreprises d’exploitation ou d’extermination et affirme encore plus solennellement la noblesse du devoir de civilisation, d’autant plus élévée que ce devoir est ardu. L’affirmation de l’unité du genre humain, typique de la tradition universaliste, ne peut donc être abandonnée mais doit être précisée dans le sens que :
« cette identité foncière est bien réelle, mais qu’elle n’apparaît pas dans les faits, que deux humanités semblent bien être en face l’une de l’autre, aussi différentes que possible, si différentes que les efforts pour transformer la seconde à image de la première semblent utopiques et vains [14]. »
L’affirmation de Raoul Allier est pour le moins obscure, témoignant bien de l’ambiguïté de la pensée coloniale. D’un côté, il affirme que l’unité du genre humain est réelle, de l’autre, que cette unité ne trouve pas d’écho dans les faits, qui démontrent au contraire l’existence de deux humanités, tellement différentes que tout effort d’unification semble vain. Comment dépasser cette ambiguïté ? Comment penser à la fois l’unité réelle et la division factuelle du genre humain ?
Pour Raoul Allier, l’unité du genre humain est réelle, tout comme l’est, dans la tradition républicaine, l’unité de la nation, fondée sur l’égalité humaine. Cette dernière précède dans un sens théorique l’institution du corps politique, constituant le but de sa réalisation et la raison de sa légitimité. Dans un autre sens, cependant, elle trouve une concrétisation dans l’institution de l’État, précisément capable de réaliser l’égalité et de défendre les droits de l’homme en les transformant en droits du citoyen.
Ainsi, l’unité du genre humain précède par principe sa réalisation concrète mais n’est pas confirmée par les faits, qui montrent encore une humanité divisée entre ceux qui ont eu accès à la raison civilisatrice et ceux qui l’attendent encore. Dire que les hommes sont égaux par principe, mais que cette égalité n’est pas encore concrète signifie que tous sont également capables de s’acheminer sur la voie de la civilisation, qui conduit à la pleine humanité de l’homme, mais que tous ne l’ont pas encore fait, que tous sont civilisables mais pas encore civilisés.
De la même façon que l’État opère l’unité de la nation en transfigurant l’homme dans le citoyen, le colonialisme réalise l’unité du genre humain en transformant le non-civilisé en un homme accompli, unifiant ainsi l’humanité divisée. Raoul Allier résume ainsi le devoir fondamental du colonialisme :
« Le problème est de faire de tous ces indigènes des hommes véritables, des hommes complets, des hommes capables de tous les progrès qui viendront à leur heure [15] »
Les ambiguïtés de Raoul Allier se comprennent ainsi comme une tentative de fonder la nécessité du colonialisme sur le plus universel des principes de la tradition française, l’unité du genre humain, dont la colonisation se propose comme instrument fondamental de réalisation.


