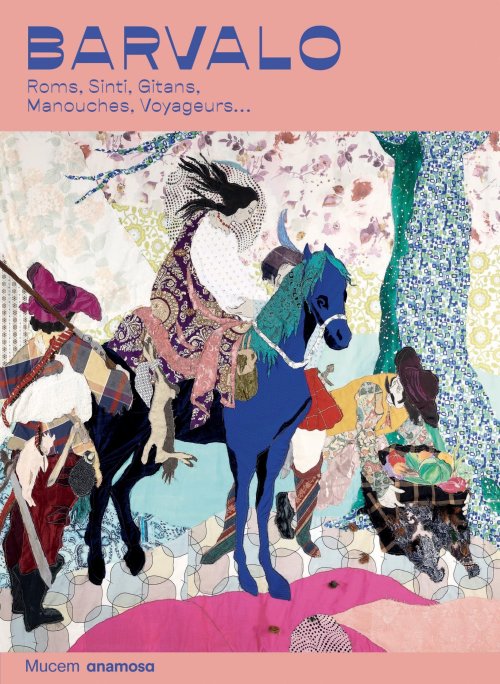L’exposition « Barvalo » comprend une innovation muséographique unique : le « musée du Gadjo », qui invite les visiteurs non romani à mettre en perspective leur histoire et leur identité à travers le filtre d’un regard romani. Il s’agit d’une forme d’exercice intellectuel afin d’inciter la majorité non romani à « renverser son regard ». Ce faisant, le dispositif offre un point de vue critique sur une forme de présentation souvent dépassée et pourtant encore dominante dans les musées ou la recherche universitaire, celle de la représentation ethnographique des cultures « exotiques », « autres » ou « minoritaires ».
En préparant cette exposition, nous nous sommes collectivement demandé comment faire pour parler de l’expérience romani d’une manière qui soit à la fois marquante et à même de créer de l’empathie chez les visiteurs non romani. La question qui guidait nos réflexions était : comment aider ces derniers à comprendre ce que cela fait de se retrouver de l’autre côté du miroir ? Le musée du Gadjo – c’est-à-dire, d’un point de vue romani, le musée de l’Autre [1] – s’est présenté à nous comme la meilleure réponse collective.
Si les populations romani ont fait l’objet d’un grand nombre de représentations déformées à travers l’histoire, ce texte montre comment certains de ses membres interviennent aujourd’hui pour renverser cette dynamique. En nous inspirant de ces stratégies de « réplique » également utilisées par d’autres groupes minoritaires [2], et par l’ironie, l’humour et la satire, nous avons imaginé de manière collaborative un « cabinet de la gadjologie », devenu ensuite « musée du Gadjo », espace à part entière de l’exposition.
Un regard déformant
Cela fait plusieurs siècles que les groupes romani font l’objet de recherches. Autrement dit, jusqu’à une époque relativement récente, la production du savoir scientifique les concernant est restée presque exclusivement l’apanage d’observateurs extérieurs, sans contribution directe des populations romani. Cette extériorité du regard a profondément modelé les savoirs populaires et académiques, et la manière dont les cultures et identités romani continuent d’être perçues par la majorité non romani. Cela n’est pas sans lien avec l’évolution même du terme par lequel les communautés romani sont souvent désignées par les personnes non romani : celui de « Tsiganes », un exonyme auquel ont été associées des connotations très péjoratives. Les pratiques scientifiques ont participé à façonner et à faire perdurer cet antitsiganisme vieux de plusieurs siècles. On en trouve d’ailleurs des traces dans la littérature scientifique elle-même [3]. L’art, la culture et les institutions culturelles non romani ont aussi contribué à perpétuer au fil des siècles une imagerie discriminante.
Ce phénomène n’affecte bien sûr pas seulement les populations romani. De nombreuses autres communautés ont été, ou sont encore, considérées de l’extérieur comme « autres », « inférieures », voire « sauvages » ou « subalternes » [4]. Le développement de l’ethnographie au début du XXe siècle et des pratiques muséographiques qui lui étaient associées a contribué à créer une hiérarchie trompeuse des cultures et des identités, plaçant les sociétés blanches et européennes ou occidentales au sommet de l’échelle. Tout cela est le résultat d’un processus d’« altérisation » qui établit une distinction fondamentale entre un « nous » et un « eux », subordonné et inférieur.
Depuis les débuts de l’ethnographie et la « découverte » de nombreuses communautés ainsi « altérisées », beaucoup de choses ont changé. Avec le temps, ceux qui étaient considérés comme de simples objets de recherche ont commencé à reprendre la parole et le pouvoir sur la manière dont on les définissait. En se réappropriant leur subjectivité et leur voix, ils ont entrepris de remodeler de l’intérieur le récit de leur propre culture, questionnant par la même occasion les hiérarchies existantes et la domination de certains groupes sociaux sur d’autres. La critique de la pratique ethnographique, souvent initiée par des représentants des sociétés étudiées, et l’influence croissante des approches postcoloniales et décoloniales dans les domaines scientifique et muséographique ont donné lieu à une nécessaire remise en question de la discipline, de sa méthodologie et des protocoles de recherche sur le terrain.
Cette autocritique a aussi vu le jour dans les musées. Les institutions culturelles, et en particulier les musées, portent une part de responsabilité dans la perpétuation des inégalités de pouvoir entre les sociétés dominantes et les communautés et cultures considérées comme marginales ou périphériques [5]. Le renouvellement des pratiques s’effectue aujourd’hui de l’intérieur des musées : en modifiant leur appellation même (en passant de la catégorie du musée d’ethnographie à celle de « musée des civilisations » ou des « cultures du monde »), en organisant la restitution d’objets (en commençant dès 1990 avec la législation du Native American Graves Protection Act) et en institutionnalisant un travail collaboratif avec les communautés sources sur les questions de patrimoine. Le pavillon chilien de la 58e Biennale de Venise en 2019 en est un excellent exemple [6] ; l’exposition, qui avait pour commissaire Agustín Pérez Rubio, offrait une nouvelle interprétation de l’histoire européenne selon une perspective décoloniale.
Quand le miroir se renverse : utiliser les « outils du maître » [7]
Une part cruciale de ce processus consiste à déplacer le regard et à le « renverser ». Que se passe-t-il alors, quand les « sujets » de la recherche redirigent la focale du regard analytique vers celles et ceux qui les étudient ?
Cela fait déjà plusieurs décennies que ce procédé est utilisé à travers le monde par des communautés minoritaires ou « subalternes », et que des débats ont lieu en leur sein sur le poids que peuvent avoir les origines ethniques sur le regard des chercheurs. Dans le même temps, l’ascension de personnes autochtones, aborigènes ou afro-américaines, entre autres exemples, à des postes de recherche a permis de repenser les relations entre les chercheurs et les personnes qu’ils étudient, et montré l’importance qu’il y avait à faire entendre des voix « de l’intérieur ». Les théories notamment postcoloniales et féministes offrent ici des outils de réflexion utiles. La recherche autochtone s’est ainsi développée « comme une alternative au mode dominant de relation au savoir qui caractérise la recherche occidentale » [8].
L’ambition était de faire « l’histoire de la recherche occidentale du point de vue des colonisés » [9]. Comme pour d’autres groupes minoritaires ou colonisés, l’attention des chercheurs autochtones portant sur « les traditions intellectuelles de leurs cultures s’appuie sur un mouvement intellectuel plus global au sein duquel les “colonisés” et les “marginaux” se sont mis à répondre au “centre” » [10]. Mais le développement de ces recherches « subalternes » ne consiste pas seulement pour les « marges » à répondre au « centre » ; il s’agit aussi pour les chercheurs et chercheuses autochtones de se tourner vers l’intérieur, en questionnant ou en explorant leurs propres savoirs et perspectives.
La méthode du « renversement » du regard permet de mettre en lumière les processus de fétichisation, de généralisation et d’exotisation des communautés minoritaires à l’œuvre dans les récits majoritaires, et leurs effets souvent délétères sur ces communautés. L’un des premiers exemples d’utilisation de cette méthode dans les musées est la performance artistique de l’artiste luiseño, puyukitchum, ipi et américano-mexicain James Luna, The Artifact Piece, au musée de l’Homme de San Diego en 1987 : allongé sur le dos dans une vitrine, au milieu d’une section du musée consacrée à la culture matérielle kumeyaay, Luna resta immobile plusieurs heures d’affilée, le bas-ventre couvert d’un simple linge, le corps entouré de cartels. Dans d’autres vitrines, l’artiste avait disposé des objets personnels et cérémoniels. Il proposait là un « point de vue autochtone » utilisant l’ironie pour se réapproprier une subjectivité effacée par le mode de présentation traditionnel du musée qui objectifiait [11] les communautés amérindiennes et les réduisait au silence [12].
D’autres exemples de « retournement du regard » opèrent ce renversement en utilisant l’humour et l’ironie pour tourner en ridicule les pratiques ethnographiques problématiques et révéler des mécanismes contribuant à maintenir des relations de pouvoir inégales entre les chercheurs et les « sujets » de leurs recherches. En 1986, le film indépendant australien Babakiueria (c’est-à-dire barbecue area) proposait une parodie de documentaire journalistique décrivant du point de vue aborigène, et sur un ton faussement sérieux et universitaire, la vie quotidienne des « Blancs dans leur milieu sauvage ». Quelques décennies plus tôt, l’anthropologue américain Horace Miner écrivait un article satirique tournant en ridicule le caractère à la fois pompeux, objectifiant, exotisant et biaisé de la voix ethnographique classique en décrivant la « culture américaine » de façon qu’elle en devienne méconnaissable pour les Américains eux-mêmes (renommés « Nacirema » – American à l’envers). En 2006, le réalisateur Mark Sandiford et le satiriste et écrivain inuit Zebedee Nungak ont créé à leur tour une parodie de documentaire, Qallunaat ! Pourquoi les Blancs sont drôles, dont le but, selon l’Office national du film canadien, était de se moquer de la manière dont les Inuits ont souvent été représentés dans les documentaires comme des objets de curiosité exotiques, en tournant cette fois l’objectif vers les Qallunaat (le mot inuit pour désigner les Blancs) et leurs comportements étranges. Le nom renvoie moins à une couleur de peau qu’à un certain état d’esprit : les Qallunaat se saluent bizarrement, répriment leurs fonctions naturelles, se plaignent d’avoir froid et veulent dominer le monde. Leurs manières étranges de se courtiser, leurs tentatives infructueuses d’explorer l’Arctique, l’autoritarisme de leurs bureaucrates et policiers ou encore leur obsession pour la propriété privée ont en effet de quoi surprendre. Nous nous sommes beaucoup inspirés de ces différents exemples dans la conception collective de « Barvalo », tout en cherchant également des initiatives plus spécifiquement romani de « renversement du miroir ».
Retournement du regard et « réplique » romani
Si, pendant de nombreuses décennies, les chercheurs non romani ont gardé un monopole quasi exclusif sur le champ des études romani, cela fait maintenant un certain temps que les communautés romani ont commencé à se faire une place dans les institutions du savoir et du pouvoir (que ce soit dans le domaine universitaire, culturel ou artistique) et à créer par ce biais un contre-discours sur l’identité et la culture romani à partir de leur propre perspective [13]. Il s’agit d’un acte moral et artistique de réappropriation des discours et récits sur l’identité romani qui vise à corriger les injustices du passé et à pouvoir enfin parler des communautés romani à la première personne. Une étape essentielle dans ce processus consiste à renverser le regard en direction de la majorité non romani ou gadjo. Autrement dit, les populations romani se sont, elles aussi, mises à « répliquer ».
Lors des débats collectifs qui ont animé la préparation de l’exposition, les nombreux membres romani de notre équipe se sont interrogés sur ce qui pouvait justement unifier ce « nous » : un nous qui, pour la plupart des visiteurs, formera un « eux ». Existait-il un élément commun entre les Manouches français, les Caló espagnols, les Kalderash roumains, les Roms ukrainiens et les Sinti néerlandais qui soit perçu de l’intérieur de ces communautés comme véritablement fédérateur, porteur d’un sentiment de solidarité et de partage ? Qu’est-ce qui pouvait unifier l’ensemble de notre projet, sans risquer d’apparaître imposé de l’extérieur ? Au fil de ces discussions, et parmi les multiples éléments qui peuvent composer l’identité romani, c’est précisément la figure de l’étranger elle-même, le gadjo, qui est apparue la plus pertinente : elle confère aux différentes communautés romani, dans toute leur diversité culturelle et géographique, une unité distinctive et incontestée, à travers l’Europe et même le monde. Dans le champ académique, le procédé de « retournement du regard » vers la majorité gadjo a été utilisé par divers chercheurs d’origine romani, parmi lesquels Ian Hancock aux États-Unis et Ron Lee au Canada. En Europe, Andrzej Mirga a eu un rôle précurseur dès les années 1980 : son mémoire de master (soutenu au département d’ethnologie de l’université Jagellon de Cracovie) avait pour titre (en polonais) « Le stéréotype du Goral (montagnard non romani/gadjo) au sein de la communauté romani du sud de la Pologne ». C’est un bel exemple de production scientifique à la fois rigoureuse et porteuse d’une voix distinctivement romani.
Durant la décennie suivante, ce type de travaux a contribué à l’émergence des études dites « gadjologiques ». Petra Gelbart, une chercheuse romani basée aux États-Unis, en est l’une des principales représentantes. Son travail analyse de manière critique le regard eurocentré sur les Roms et explore ses effets sur la vie des communautés romani. Heather Tidrick, en parlant de manière volontiers provocatrice de « gadjologie » ou « gadzologie », a montré elle aussi l’importance qu’il y a à écrire « à partir d’un point de vue romani sur les systèmes, les structures et les discours contrôlés par les personnes non romani et la manière dont elles affectent l’existence et les possibilités offertes aux personnes romani » [14]. On peut aussi citer l’important travail de Gilda-Nancy Horvath (avec son texte « Das Volk der Gadje in Europa » (« Le peuple des Gadjé en Europe »)), ainsi que la « Gadjo Lore Society » (ou « société folklorique du Gadjo ») imaginée par un groupe de chercheurs romani anglophones, dont Ian Hancock, en 2003, en écho à la « Gypsy Lore Society » fondée en 1888 par des chercheurs non romani pour étudier les populations romani.
Partant de ces exemples, nous avons imaginé une partie de l’exposition qui tournerait autour de cette idée semi-humoristique d’un champ d’étude « gadjologique », reprenant les procédés généraux de la parodie en lui donnant une perspective romani ancrée dans les expériences propres aux populations romani d’Europe. L’idée d’un « cabinet de gadjologie » au sein de l’exposition était née.
Du « cabinet de gadjologie » au « musée du Gadjo »
Nous avons alors commencé à dresser un portrait humoristique du Gadjo, une sorte de figure stéréotypée imitant les manières réductrices et exotisantes selon lesquelles les populations romani sont fréquemment dépeintes par les Gadjé. Cette perspective permettait de mettre en lumière les représentations biaisées qui, pendant des siècles, ont été véhiculées par l’art et les études savantes, et perçues par le public comme des vérités objectives, et de formuler ainsi une autocritique audacieuse des musées ethnographiques dans leur manière habituelle de présenter les cultures romani sous un jour déformant.
Recourir à l’humour, la satire et la parodie pour sensibiliser le grand public aux complexités du racisme qui imprègne les représentations des populations romani par les autres n’est pas un exercice facile, d’autant plus lorsqu’on adopte, comme l’équipe curatoriale a choisi de le faire, une approche « dialogique » mettant en scène un « autre », dépeint par un groupe qui a lui-même souffert d’être altérisé. Le procédé peut risquer d’être mal compris, soit en étant interprété de manière littérale, soit en étant perçu comme trop érudit et obscur. Il peut néanmoins s’avérer très efficace pour faire comprendre aux visiteurs le fonctionnement des représentations, le fait de construire une représentation et d’être représenté à son tour. Le dispositif permet de leur poser les questions suivantes : qu’est-ce que cela fait d’être à notre place ? Et si c’était vous ? Cela donne aux visiteurs des outils pour mieux comprendre ce que cela peut faire d’être objectifié, et d’être soumis à des images et des représentations déformantes et blessantes, comme les populations romani en font souvent l’expérience de la part des Gadjé. Pourquoi, peuvent se demander les visiteurs, les Gadjé ne font-ils jamais l’objet des mêmes représentations stéréotypées et ultra-médiatisées que subissent les populations romani ?
S’ils appartiennent à une « majorité », les visiteurs pourront, du moins nous l’espérons, se demander pourquoi ils tendent à ne pas être représentés de cette façon-là ; ou bien au contraire pourquoi ils tendent à l’être, lorsqu’ils appartiennent à un groupe soumis à des modes d’objectification de type orientaliste, par exemple. À travers l’hyperbole et l’exagération, l’humour permet de faire prendre conscience de ces processus tout en montrant clairement que le récit présenté n’est pas à prendre de manière littérale, ce qui crée le décalage nécessaire pour faire passer le message [15]. C’est un procédé très répandu dans les musées pour questionner les visiteurs, essayer de remettre en question leurs certitudes et surtout leur permettre d’exercer leur esprit critique [16].
C’est dans cette optique que nous avons voulu créer un « musée dans le musée », satirique et présentant la « culture gadjo » du point de vue romani. C’est ainsi que le « cabinet de la gadjologie » s’est transformé en « musée du Gadjo ». Tout en élaborant les contours de notre projet, il nous est apparu bien entendu essentiel qu’il soit conçu de l’intérieur par des créateurs et artistes romani.
Le « musée du Gadjo » est une innovation muséographique imaginée de façon collaborative et mise en œuvre par l’artiste romani français Gabi Jimenez à travers une installation artistique originale. Ce « musée dans le musée » propose de mettre en scène une vision de l’Autre à la façon du musée ethnographique du début du XXe siècle. Pour ce faire, nous avons réutilisé les découpages stéréotypés propres à ce type de présentation : rites et croyances, habits traditionnels, habitat. Tout cela, suivant une vision évolutionniste du Gadjo, en passant en revue les processus historiques et sociaux qui l’ont conduit de la sédentarisation à notre époque. De manière autocritique et volontairement essentialisante, le musée du Gadjo expose une sélection d’objets sortis de leur contexte, comme on peut en trouver dans les musées de société, et qui donnent une vision stéréotypée de la société des « Gadjé ». Le but est d’utiliser la satire pour aider les visiteurs à comprendre comment le racisme et la distorsion peuvent opérer à travers des représentations quotidiennes et si normalisées que l’on a rarement l’habitude de les questionner.
Suivant une forme de mise en abyme, le dispositif interroge aussi l’image de temple du savoir que l’on a souvent des musées, en montrant qu’une exposition exprime le point de vue de celles et ceux qui la conçoivent, et non une vérité ultime. Pionniers d’un type d’exposition ethnographique combinant humour et réflexion critique, Jacques Hainard et Marc-Olivier Gonseth écrivaient en 1995, dans le manifeste accompagnant l’exposition « La Différence » au musée d’Ethnographie de Neuchâtel :
« Exposer, c’est construire un discours spécifique au musée, fait d’objets, de textes et d’iconographie.
Exposer, c’est mettre les objets au service d’un propos théorique, d’un discours ou d’une histoire et non l’inverse.
Exposer, c’est suggérer l’essentiel à travers la distance critique, marquée d’humour, d’ironie et de dérision.
Exposer, c’est lutter contre les idées reçues, les stéréotypes et la bêtise. […]
Dans un tel cadre, les objets ne sont pas exposés pour eux-mêmes mais parce qu’ils s’insèrent dans un discours, parce qu’ils deviennent les arguments d’une histoire qui met en perspective l’une ou l’autre de leurs caractéristiques, que celles-ci soient esthétiques, fonctionnelles ou symboliques. Qualifiée parfois de critique ou de déstabilisatrice, une telle démarche vise à permettre aux visiteurs de relativiser leurs perceptions, de déconstruire leurs savoirs et d’interroger leurs certitudes afin de les amener à repenser leur réalité. » [17]
Avec l’installation de Gabi Jimenez, nous voulions tout particulièrement questionner de manière taquine le mode de présentation en vigueur au MNATP (musée national des Arts et Traditions populaires). D’une certaine façon, le musée du Gadjo imite les « unités écologiques » de l’ancien musée, une pratique de reconstitution qui allait au-delà du diorama : on trouvait par exemple un atelier de forgeron alpin, un cabinet de voyance parisien, ou encore la salle à manger d’une famille de fermiers bretons. Chaque élément de ces pièces était collecté sur le terrain puis l’ensemble était scrupuleusement reconstitué au musée, tel qu’il avait été trouvé dans son environnement d’origine. L’ambition était de donner une image aussi précise que possible des pratiques sociales dont ces espaces et leurs objets témoignaient.
En conclusion, il importe de souligner que toutes les représentations biaisées ne se valent pas dans leurs implications et leurs effets. En effet, s’il se trouvera peut-être des visiteurs pour répliquer qu’une minorité peut elle aussi avoir un point de vue discriminant vis-à-vis d’un groupe non minoritaire, il est évident que la représentation en question ne reçoit généralement pas le même poids, le même appui ; elle n’acquiert pas suffisamment de force pour contribuer à créer ou entretenir des injustices, et ce à l’échelle de structures macrosociales, de l’école à la police en passant par les médias et l’État lui-même. Les visiteurs seront encouragés à s’interroger sur la manière dont ces structures de pouvoir déterminent quelles représentations l’emportent, avec des conséquences parfois délétères pour les populations visées, voire mortelles, comme l’Histoire nous l’a montré. Sous des apparences espiègles, le musée du Gadjo s’attaque donc à une question très sérieuse.