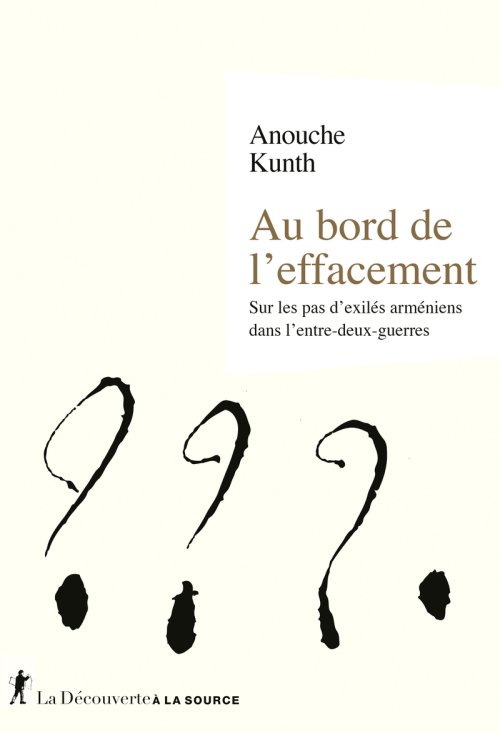Il arrive que des pointillés apparaissent à la place du nom de la mère – de son nom de jeune fille. Trois points : poussière dans l’œil, ils troublent la vue, arrêtent.
Est-ce à dire que la mère est décédée ? Absente, du moins, de telle manière que l’attestation du lien de filiation n’a pu se faire entièrement. Selon cette hypothèse, l’absence s’étend à tout l’entourage familial et, bien entendu, au père. D’où vient, sinon, qu’il n’ait pu fournir les renseignements et indiquer le nom manquant de cette femme, fût-il séparé d’elle, veuf ou simplement sans nouvelles ?
Quelle histoire se replie dans trois petits points ?
D’une interrogation l’autre, ces pointillés se remplissent d’inconnu. Ils suggèrent la destruction des familles et de ceux qui gravitaient autour, des liens d’interconnaissance grâce auxquels les identités personnelles sont assurées au sein d’un groupe social, tant par le jeu des contacts quotidiens que par le relais des mémoires particulières. De là provient la valeur de ces petites marques de ponctuation : elles rendent l’idée d’irréparable. Ce n’est qu’après avoir traité quelque huit mille pièces que confirmation est venue, explicite comme rarement, donnée sans détour dans une brève annexe :
Mlle Krikorian étant orpheline et ne connaissant pas le nom de naissance de sa mère, nous n’avons pu inscrire que le prénom
Ce qui est ignoré ne peut s’énoncer mais se note, cependant. Se ponctue. Se transmet dans la trame écrite sous la forme d’une fine déchirure. Indice de la disparition, part d’irrésolu. L’orpheline a trente ans lorsque le certificat lui est remis, griffé de pointillés. Elle reste sans réponse.
Chose étrange, un peu boiteuse : le prénom de la mère est toujours donné, quand le nom de naissance ne l’est pas. Le caractère systématique de cette boiterie interroge de nouveau sur le travail opéré par les établissements de secours aux orphelins pour rétablir les identités perdues, oubliées, inconnues. « Elles ignorent la date de leur naissance et ont à peine le souvenir de leurs parents dont elles ont été séparées si jeunes ! » constate, désemparée, la sœur supérieure du monastère franciscain de l’Immaculée Conception, qui se prépare à accueillir dans son orphelinat de Lons-le-Saulnier un petit groupe d’Arméniennes. Rien n’est simple pour faire venir dans le Jura ces jeunes filles cantonnées au Liban, sans ressources et, parfois pire, sans nom propre. La religieuse s’ouvre au sénateur Victor Bérard – hautement concerné par le sort des Arméniens ottomans – de la difficulté, sinon de l’« impossibilité » d’établir avec justesse leur état civil : « (surtout après le bouleverse- ment de la guerre) », précise-t-elle entre parenthèses.
Il a bien fallu recomposer ces identités perdues. Inventer, si nécessaire. Jusqu’à combien de patronymes ? Un seul, si l’on en juge par les certificats – en remplacement de celui du père.
Revenons aux pointillés. Ils ne sont guère plus qu’un signe, mais ne bloquent pas pour autant le signifié. Tapés à la machine à écrire sur un document administratif, ils suggèrent une réalité, celle des filiations détruites pendant le génocide. Ils sont une figuration du manque, une convention s’articulant à des points de douleur laissés hors du langage. Le dispositif n’est pas sans évoquer la sémiotique de la disparition que propose Georges Perec dans W ou le Souvenir d’enfance, lorsqu’il médite sur son écriture conçue pour dire rien – dire le rien de la disparition scandaleuse de ses parents et du silence qu’ils garderont à jamais. Une écriture blanche, neutre, en elle-même « signe une fois pour toutes d’un anéantissement une fois pour toutes ».
Le lien avec les pointillés se fait plus nettement encore lorsque Perec explicite la valeur que prend à ses yeux un souvenir imaginaire. Celui d’avoir eu le bras en écharpe le jour où sa mère l’a emmené gare de Lyon pour le confier à la Croix-Rouge ; départ de l’enfant, six ans, en zone libre. Mise à l’abri. Rétrospectivement, Perec sait que ce jour fut celui de la séparation ultime d’avec sa mère. Auprès d’elle sur le quai, il se revoit donc le bras en écharpe. Le démenti ultérieur de sa tante – jamais il ne fut nécessaire, non, de se faire passer pour blessé –, tout comme le doute entourant la réalité d’une fracture à l’omoplate après une chute à la patinoire n’en disent que mieux le désir de Perec d’être soutenu dans sa douleur par des leurres, des simulacres de blessure et de protections thérapeutiques. Aussi commente-t-il, au sujet des bandages censés l’avoir entouré :
« Ces points de suspension désignaient des douleurs nommables et venaient justifier les cajoleries dont les raisons réelles n’étaient données qu’à voix basse. »