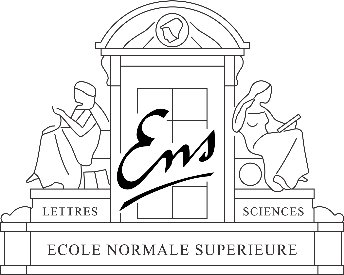
Nous ne parlons qu’en nos noms, ce qui ne signifie pas que ce que nous disons n’a aucun sens. Notre discours est marginalisé, ce qui ne signifie pas qu’il est fictif. Nous sommes un groupe de personnes assignées femmes et de personnes trans, qui subissons dans nos vies et dans le cadre de nos études à l’ENS (Ecole Normale Supérieure), des oppressions et agressions sexistes, lesbophobes, transphobes et biphobes. Notre parole est collective et anonyme, parce que nos conditions de vie dans cette école ne nous permettent pas de montrer nos visages. Nous avons témoigné de ces violences, ainsi que des propos racistes que nous avons souvent entendus dans l’école - bien que, depuis notre position de blanc-he-s, nous ne soyons pas les mieux placé-e-s pour en parler - dans un article paru lundi 9 janvier sur Rue89, et la réaction « collective » des normalien-ne-s scandalisé-e-s que l’on ternisse l’image de « leur école » n’a pas tardé.
Une pétition circule en effet depuis le jeudi 12 janvier, qui vise à nier la véracité des faits que nous dénonçons. « Aidez-nous à montrer qu’en tant qu’élèves et étudiants, nous aimons notre école et nous y sentons bien ! » : c’est le message final de cet acte de déni, que la direction de l’école soutient puisque le mail a été envoyé sur le serveur « élèves ».
Nous persistons dans notre colère et diffusons ce texte, qui relate et analyse plus profondément les problèmes posés dans l’école par la présence du Bureau des Elèves, en liant les thèmes féministe, anti-capitaliste et l’anti-LGBTphobie. Notre réflexion s’ancre dans le contexte que nous connaissons, celui de l’ENS, mais il semble que ces atrocités se produisent dans d’autres lieux, c’est pourquoi nous nous permettons de parler des « BDE » en général, en tant qu’institutions.
Contrairement aux organisations politiques, qui se fédèrent autour d’une pensée commune, ou du moins autour de l’adhésion partagée à un ensemble de valeurs ou de revendications, les « Bureaux des Elèves » des « grandes écoles » se rejoignent autour d’une sociabilité commune, qui n’est a priori pas fondée politiquement – mais comme nous allons le voir, ce partage est loin d’être aussi simple. A l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, le BDE s’appelle COF (Comité d’Organisation des Fêtes). Le rapport des adhérent-e-s du COF à la structure est un rapport de stricte consommation : les personnes qui paient 100 euros au début de l’année ont accès à un certain nombre d’activités (culturelles, sportives et autres) et aux soirées de l’école – traduction en langage militant : du moment que les personnes ont payé leur « cotisation », elles sont plus ou moins autorisées à agir comme elles l’entendent. Le cadre institué est permissif, on le considère comme « libéré » (des contraintes que constituent le respect des personnes et la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, homophobes, lesbophobes, biphobes, transphobes, racistes..).
Quel-le-s que soient les individu-e-s qui participent aux activités du COF (tou-te-s ne sont pas infect-e-s, et il ne s’agit pas de porter de jugement de valeur sur les personnes mais de condamner le fonctionnement d’une institution), le dispositif mis en place année après année permet aux dominations (du groupe des hommes sur le groupe des femmes, du groupe des hétérosexuel-le-s sur le groupe de celleux qui ne le sont pas, du groupe des personnes cisgenres sur le groupe des personnes trans, du groupe des blanc-he-s sur le groupe des personnes racisées, et autres) de produire les violences qui en émanent structurellement, quand rien n’est fait pour lutter contre.
Ces violences sont niées, tues, taboues. Si par exemple deux filles s’embrassent « librement » pendant une soirée de l’école, c’est la preuve absolue que la lesbophobie n’existe pas - peu importent les dizaines de réflexions agressives qu’elles auront subies : ce sont des « blagues », et ne pas en rire, ça plombe l’ambiance. De la même façon, si un garçon estime qu’il peut toucher les seins des plusieurs filles en public et sans leur consentement, il est « un peu relou », mais il ne s’agit en aucun cas de violences sexuelles. Il est beaucoup plus sympathique de parler de « mains baladeuses » - à qui appartiennent ces mains, et où se baladent-elles, autant de questions « un peu » féministes, donc complètement hors de propos, puisqu’ « on est là pour faire la fête ».
C’est ainsi que le développement des « BDE » crée de fait des lieux où les dominations sont exacerbées, d’autant plus qu’elles ne sont ni identifiées, ni combattues, la plupart du temps, par les organisations militantes. A l’ENS, l’extériorité quasi-totale des syndicats et du Collectif féministe par rapport au COF favorise ce déchaînement de violences.
Apolitisme = hypocrisie
Ces organisations se définissent d’abord et avant tout par un rejet très fort de tout ce qui a trait au “politique”, domaine qu’elles ne définissent que vaguement, et qui a de fait un caractère très large et flou. Mais ce n’est pas qu’une définition négative, dans une opposition par exemple à un mode d’organisation de type syndicat : il y a une forme de militantisme paradoxal dans la façon dont ces organisations prônent leur caractère apolitique, et font en sorte d’exclure toute réflexion politique de leurs actions. A titre d’exemple, le « club LGBT » de l’ENS, appelé depuis quelques années l’ « Homônerie » (nom qui invisibilise la présence des lesbiennes, des bisexuel-le-s et des personnes trans, mais dont il faut reconnaître que c’est un progrès puisqu’autrefois le groupe s’appelait « Homonormalité » !), appartient au COF.
Par conséquent, certaines de ses actions « coup-de-poing », comme une campagne d’affichage à l’occasion de la Journée Mondiale contre l’Homophobie (mes aïeux, si ça, ce n’est pas du radicalisme !) sont censurées par le COF. Car si la lutte contre l’homophobie est « politique », il faut croire que l’homophobie ne l’est pas. L’Homônerie est donc priée de ne pas faire de « prosélytisme » et d’organiser des soirées conviviales, comme tout le monde. Si pendant l’une de ces soirée, un type décide de hurler « Les gays, je vous encule tous ! » à quatorze reprises et de manière explicitement agressive, il ne faut pas lui demander de partir - ce serait violent - mais le laisser faire la fête, car c’est son droit : il a payé sa cotisation en début d’année, c’est un membre du COF, pas touche.
Les comportements homophobes ne sont pas la seule conséquence de l’apolitisme revendiqué des BDE. En effet, pour divertir convenablement ce public exigent, il faut trouver de l’argent. La compromission avec le privé est alors patente, et vécue toujours comme non « politique » : le financement des BDE repose majoritairement, en plus de la cotisation de leurs membres, sur des partenariats avec le privé, sous forme de sponsors. A l’ENS, l’un des sponsors du COF est une marque de préservatifs : Capricia. Pendant la soirée « Rouge et Noir(e) », organisée par l’Homônerie, le COF a très mal vécu le fait qu’une personne arrache les affiches publicitaires de Capricia, qui en plus d’être des affiches publicitaires, étaient hétérosexistes (un corps de femme proposait des préservatifs dits « masculins »).
Les BDE ont un fonctionnement entièrement capitaliste, et ont même été créés à la base dans les écoles de commerce comme une simulation efficace du travail en entreprise : recherche de sponsors, organisation en équipes (les « listes »), qui s’affrontent, pour que la plus compétitive (celle qui sera paradoxalement « élue » par l’école ou la fac) triomphe. Une fois la liste élue, la simulation continue : il s’agit d’apprendre le travail en équipe, mais aussi à savoir obéir à la hiérarchie (il y a toujours un-e « président-e » de liste, qui fait figure de représentation, mais dont les décisions ont aussi plus de poids), et au « principe de réalité économique », incarné par le/la trésorier/ère.
Ce mode d’organisation ultra-capitaliste n’est jamais interrogé politiquement, et apparaît comme le fondement de leur apolitisme, avec pour principale conséquence que la loi qui prime le plus souvent est celle de l’argent. Si un prestataire a ouvertement un comportement discriminant (sexiste, lesbo-, gay-, bi-, trans-phobe, etc.), on n’en changera pas, du moment qu’il propose ses services au prix le plus concurrentiel : à l’ENS, le COF a refusé de rompre son partenariat avec un prestataire qui avait commis pendant le week-end d’intégration des actes de harcèlement sexuel. Lors de l’ « AG » du COF, quand le problème a été soulevé, l’un des membres du bureau a dit dans son micro, en parlant des victimes :
« Elles n’attendaient que ça ! ».
Le pouvoir des BDE provient en grande partie de leur pouvoir financier. A l’ENS, le COF joue même le rôle de banque pour les élèves, qui peuvent emprunter des sommes considérables, à taux zéro. Merci Capricia. De quoi se plaint-on ?
L’administration = bonne nuit les petits
Pour l’administration, ces organisations présentent l’énorme avantage de ne pas être politiques, si bien que même si elles donnent une mauvaise image de l’école, elles sont toujours moins néfastes que les « gauchistes », les féministes, et leurs revendications. De fait, elles apportent aussi un divertissement pratique pour tou-te-s les élèves, et ce à moindre prix. L’administration subventionne souvent très largement les BDE. A l’ENS, le COF reçoit chaque année 13.000 euros de la part de la direction de l’école, somme prélevée sur un « fonds d’aide sociale ». Avec cet argent, et celui que les membres du bureau du COF dénichent en offrant à des « sponsors » un accès direct aux cerveaux des normalien-ne-s, les « clubs » de l’école peuvent organiser des rencontres sportives ou culturelles. On ne s’étonnera pas de l’attitude complaisante de l’administration, qui a tout intérêt à ce que les petit-e-s normalien-ne-s s’amusent gentiment entre eux et elles, au lieu d’aller se mélanger avec leurs inférieur-e-s. Dans beaucoup d’écoles, et notamment à l’ENS, on peut entendre des expressions comme « choper du propre » (coucher avec du « propre », c’est coucher avec quelqu’un-e qui appartient à une « grande école », comme « nous »). Certain-e-s élèves intériorisent la « fierté normalienne » et autres abominations élitistes encouragées (sinon dictées) par l’administration.
Les rapports entre le COF et l’administration sont conçus sur le modèle des relations familiales, supposément hors de la politique - et c’est pourquoi les « petits problèmes » comme les propos sexistes, racistes ou lesbophobes dans le journal de l’école (un autre club du COF) sont réglés sur le mode de la réprimande. Et si l’administration consent une fois l’an à convoquer quelques uns des auteurs de ces agressions quasi-hebdomadaires pour leur taper sur les doigts en leur adressant un sourire bienveillant, c’est pour mieux fermer les yeux sur les autres violences qui lui sont signalées – et dans lesquelles elle a, naturellement, plus que sa part de responsabilité.
« Nous », ce micro-monde
Le BDE est hégémonique au sein de l’école : il a pour vocation de s’occuper de l’ensemble de la sociabilité des élèves de l’école. Aucune activité ne sort de son cadre : ainsi, il se décline en Bureau Des Arts (BDA), Bureau Des Sports (BDS), etc. Se trouve ainsi offerte la possibilité de passer l’ensemble de la vie au sein de l’école, sous le contrôle attentif du BDE : sports, sorties, fêtes ... tout est pris en charge. Le BDE maintient ainsi la cohésion de la “communauté”, et crée à l’identique un esprit de clan, qui ressemble beaucoup à l’esprit d’entreprise, et qu’il nomme “esprit d’école”.
L’une des conséquences les plus immédiates de cet état de fait en est l’homogénéisation, l’uniformisation des comportements. La résistance devient presque impossible dans la mesure où le groupe contrôle une grande partie de la vie des individu-e-s, et de la vie de l’école. Cela va immanquablement vers une acceptation des dominations, une moindre résistance à leur exercice - qui va de pair avec l’illusion d’être dans un espace de non droit - et une droitisation massive... A l’ENS, l’ensemble de ces pratiques crée l’illusion d’un « nous » qui a des effets bien réels, comme l’identification d’une partie des élèves à l’école - que révèlent certaines réactions à l’article paru sur Rue 89, de normalien-ne-s offensé-e-s par la critique adressée à « leur » ENS chérie.
Ce « nous » collectif s’oppose bien évidemment aux « autres », qui sont à l’extérieur comme à l’intérieur. Parmi les « autres » de l’extérieur, on trouve les autres lointains : les étudiant-e-s des facs, stigmatisé-e-s en permanence par le « discours normalien » - ou pire encore, les personnes qui ne font pas ou n’ont pas fait d’études. Un racisme de classe décomplexé est de mise lorsqu’on discute, dans la cour ou dans les couloirs, de telle « carrière prometteuse » …
« Rejoignez l’excellence » : tel est bien le slogan de l’ENS d’Ulm !), et les autres proches (des ENS autres donc « rivales », comme Lyon ou Cachan, dont les étudiantes, pendant les Inter-ENS, compétitions sportives qui opposent chaque années les différentes ENS entre elles, se font insulter en ces termes sexistes :
« On n’entend pas sucer les Cachanaises ! »
... tandis que de leur côté, les Cachanais crient :
« Ulmites, sodomites ! ».
Sur le « campus » du 45 rue d’Ulm, le terme « extérieur » désigne toute personne qui n’est pas élève à l’école. Ainsi, s’il y a des « vols » de yaourts dans les frigidaires des internats, ce sont forcément les « extérieurs », et l’administration pense d’emblée à installer des « portes badgées », qui filtreraient les passages dans les couloirs de l’internat, pour faire le tri entre les élèves et les clochard-e-s du cinquième arrondissement, dont la présence dans les locaux de l’école est au demeurant complètement fantasmée. Cette logique sécuritaire est très présente à l’école, quand il s’agit de protéger le groupe majoritaire d’attaques imaginaires. Heureusement, des considérations sécuritaires d’un autre genre ont empêché cette mesure absurde d’être appliquée : la crainte qu’en cas d’incendie, tou-te-s les normalien-ne-s qui sortiraient de leur chambre sans leur « carte multi-fonctions » finissent carbonisées l’a emporté sur la nécessité absolue de protéger les précieux yaourts et autres mousses au chocolat.
De la même façon, quand un problème survient en soirée, par exemple une agression sexuelle, les « extérieurs » en sont rendus responsables. En octobre 2011, un e-mail étudiant a beaucoup circulé dans l’école. Son auteur racontait à ses copains les « gorets » (sic) la soirée du 13 octobre. Cette soirée, organisée en K-Fêt, dans le sous-sol de l’école, célébrait la ré-ouverture de la K-Fêt, qui avait été fermée pendant un moment par l’administration, à la suite du coma éthylique d’un élève auquel personne n’avait porté secours. Voici ce que raconte Mika :
« C’est ainsi que la troupe de gars bonnard se ramene avec une chaussette
sur le sexe et enflamme le dancefloor ! Qqs biffles sur le podium,
frottements de couilles sur la gente féminine, sans compter la pose de
couilles sur le comptoir du bar. Une autre envie d’uriner mais la flemme de sortir. Avec des verres vides à dispositions, c’(est avec mes deux fillots que nous avons tenté une variante du lancer de poids, avec des verres jaunes.
On resort prendre l’air car on s’étouffe vite dans la kfet ! Les rugbymen
intellectuels commencent alors à insulter tous les jeunes autour, et à
emprunter des chapeaux ou des casquettes. On a d’ailleurs trouvé marrant
de trickser un homosexuel véti d’une paire de bretelles, d’un pantalon en
cuir et d’une casquette en cuir ! Le pauvre, ce qu’on lui a mit. Mais la
bonne humeur des porcelets l’a emporté sur l’envie de mettre quelques
droites. »
Quand le Collectif féministe a diffusé ce mail dans l’école (« Et c’est nous qui sommes agressives ? »), le COF et la K-Fêt se sont empressés de « condamner » ces actes commis par des « extérieurs ». Or, le mail de Mika indique clairement que si rien n’a été fait pour arrêter ces agresseurs (la soirée a duré plusieurs heures, au cours desquelles ils n’ont pas cessé d’infliger des violences sexuelles, sexistes et homophobes (et encore, il est certain que nous ne savons pas tout), l’équipe K-Fêt a cautionné leurs actes. En effet, Mika mentionne plusieurs noms de membres de l’équipe K-Fêt, qui rappelons-le, est chargée de s’assurer que les soirées se déroulent « bien » (pour qui ?) : un tel leur « paye une tournée », une autre leur « paye pas mal de coups ».
Officiellement, la K-Fêt et le COF ont cependant trouvé ces évènements regrettables - du moins dès lors que le Collectif féministe les avait publicisés. Il faut donc exclure ces « extérieurs » - et surtout ne pas réfléchir à la façon dont le cadre de la soirée leur a permis d’agir comme ils l’ont fait. Ce qui s’est passé pendant cette soirée est accidentel, et en aucun cas la conséquence structurelle de l’organisation du BDE.
On retrouve le même discours de déni dans la « réaction des élèves » à l’article paru sur Rue89 : certes, il existe des « cas isolés », mais enfin de là à « généraliser »... Ce ne sont bien sûr que des « dérapages », et en fin de compte, c’est presque comme si ce n’était pas arrivé. En tout cas, quelle idée d’aller le raconter aux médias ! De salir l’image prestigieuse de l’ENS, de laver son linge sale sur la place publique !
Il y a enfin les « autres » de l’intérieur : les minorités implicitement exclues du « nous ». Ces organisations fonctionnant sur une forte cohésion de groupe, et sur le sentiment d’appartenance à ce groupe qui n’est jamais interrogé : il s’agit de créer parallèlement des exclusions qui justifient l’intégration. Cette sociabilité met en place des signes de reconnaissance : un « esprit de fête » potache, un certain humour, mais aussi une stigmatisation permanente des un-e-s et des autres qui recoupent des enjeux de pouvoir. C’est en descendant les autres qu’on monte dans la hiérarchie, c’est en excluant certain-e-s du groupe qu’on renforce la cohésion interne de ce dernier. La menace de l’exclusion (jamais formulée explicitement, mais puissante dans l’esprit de chacun-e avec la peur de voir ses propres ami-e-s se retourner contre soi) empêche toute forme de résistance une fois qu’on est pris-e dans le réseau.
Les enjeux de pouvoir sont énormes : il s’agit non seulement de perdurer dans l’organisation, d’obtenir la plus grande reconnaissance des autres, mais aussi de contrôler l’organisation, de commander les autres... pour assurer sa propre place. On relève une absence flagrante des idéaux démocratiques, même à l’état le plus consensuel : la hiérarchie et la présence de chef-fe-s sont absolument revendiquées. Mais paradoxalement, ces organisations parviennent à faire croire à leurs adhérent-e-s qu’ils/elles représentent l’ensemble des élèves, reprenant par exemple à leur compte la notion d’AG.
Pendant ces « AG », le groupe se soude autour d’une pensée commune. On y fait par exemple tranquillement l’apologie du viol correctif, comme ce membre du COF au micro, au sujet des militant-e-s du Collectif féministe :
« On va les mettre enceintes, ça va les calmer ! »
On affiche entre personnes blanc-he-s un racisme décomplexé :
« Au COF, on aime les Noir-e-s ! »
Toujours au micro, parce que l’ordinateur avait planté et que l’écran était devenu noir...
On stigmatise les membres de l’association LGBT quand illes réclament un budget pour organiser une soirée :
« Prenez l’argent du club cirque, et mettez-vous des massues dans le cul ! ».
Ne pas adhérer à cette forme de sociabilité que beaucoup d’hommes normaliens blancs et hétérosexuels qualifient de « potache » ou de « bon esprit » revient à remettre en cause les fondements du groupe, et conduit à l’exclusion ou à l’auto-exclusion. D’autres sociabilités existent bien sûr à l’école, mais aucun groupe n’est aussi puissant que celui que forment les adhérent-e-s du COF au sens large, et celleux qui « tiennent » le COF et la K-Fêt en particulier.
L’existence depuis décembre 2010 d’un Collectif féministe et les agressions répétées qui le visent depuis sa création ont permis de confirmer l’omniprésence et l’omnipotence du groupe majoritaire comme le traitement réservé à celleux qui ont le courage de dénoncer les violences qui en émanent. Depuis un an et demi, nous ne comptons plus les mails d’insultes, les articles moqueurs (au mieux) dans le Bocal (« journal » chapeauté par le COF, donc financé par la direction de l’école), les messages agressifs sur notre panneau, et les propos sexistes, transphobes, lesbophobes, biphobes et anti-féministes entendus dans l’école. Tout a été fait pour que nous abandonnions notre lutte. Sous couvert de veiller à ce que la vie étudiante ne soit pas envahie par des conflits politiques (donc hors de propos puisque notre petit paradis n’est manifestement pas situé dans le monde réel), le groupe majoritaire a tenté et tente toujours d’étouffer notre parole et de décourager notre action.
Le sexisme s’exprime de la manière la plus explicite : un pénis géant a été dessiné sur notre panneau (un autre orne le mur du gymnase depuis le gala de l’école – grande cérémonie de connardise avec « tenue correcte exigée »). Un étudiant nous envoie par mail la « blague » suivante :
« - Que dit-on à sa femme quand elle rentre à la maison avec deux yeux au beurre noir ?
- Rien, on lui a déjà dit deux fois ! ».
Notre campagne d’affichage contre les violences sexuelles a été perçue comme « agressive » et nous a valu nombres de commentaires, au mieux paternalistes, au pire injurieux, souvent les deux. Nous nous étions pourtant contenté-e-s de slogans dont la radicalité nous échappe encore, comme :
– « Mon corps m’appartient. Les biffles et les mains au cul ne sont pas des actes anodins mais des agressions sexuelles » ;
– « Reproduire sous forme de blagues les dominations sexistes et LGBT-phobes, ce n’est ni drôle ni subversif, c’est lâche et violent ».
L’imbécillité s’organise. L’anti-féminisme est fédérateur. Jamais bande de crétins n’a été si unie.
Privilèges = liberté
Les BDE agissent avec le sentiment de la plus parfaite impunité. Soutenus par la reconnaissance sociale d’appartenir à une « grande école », par la puissance économique de leurs partenariats, leur hégémonie sur l’école, et le soutien de l’administration, ils défendent ouvertement le fait que les lieux qu’ils tiennent sont des lieux de non droit, qu’ils présentent sous la forme attractive de lieux de liberté absolue. Leur illusion de puissance est tellement forte que le simple rappel de la loi n’est jamais un motif reconnu comme valable, valide. Ils ne s’en inquiètent que médiocrement, et de fait, la seule instance à laquelle ils doivent rendre des comptes, est l’administration (qui est de leur côté pour les raisons citées précédemment). Les BDEs s’emparent des nouveaux/elles venu-e-s dès leur arrivée dans l’école.
Le week-end d’intégration joue à ce titre un rôle très particulier : désigné comme le moment où le groupe se forme, il est synonyme de déferlements de violences en tout genre pour s’unir derrière un même rejet de tout ce qui ne s’apparente pas au groupe, mais aussi de moments d’humiliation, qui apprennent dès le départ à respecter la hiérarchie. Toutes les activités proposées reposent sur cette double composante, et se reproduisent d’année en année. Il s’agit officiellement d’apprendre à se connaître, de repousser ses limites dans une illusion de toute puissance jamais démentie. Pour cela, l’alcool coule à flots, sans qu’aucune campagne de prévention sur les risques qu’il génère ne soit jamais déployée, sous peine de « casser l’ambiance ». Dans les écoles de commerce, le phénomène est connu : les entreprises proposent aux BDE de l’alcool a des prix défiant toute concurrence, sachant pertinemment qu’elles forment leurs futur-e-s consommateurs/trices en les rendant dépendant-e-s dès leur jeunesse. Par la suite, les soirées rythment la vie de l’école, remplaçant ponctuellement mais constamment le rôle premier qu’avait joué le week-end d’intégration.
L’injonction à boire, à faire la fête, à rentrer dans le jeu sexuel est permanente. Les personnes qui s’y opposent sont de fait exclues du groupe. On retrouve au sein de ces organisations les mêmes injonctions contradictoires du discours social sexiste, qui dictent aux personnes assignées femmes la conduite à tenir pour être « respectées » :
Sois sexy, mais ne sois pas une pute !
Sois libérée, mais aie toujours besoin de notre approbation !
Etc.
On prétend ainsi pousser à une libération sexuelle, tout en continuant à stigmatiser celles et ceux qui ne rentrent pas dans la norme sociale, par exemple avec l’élection d’une « Miss écarte les cuisses » (et corrélativement d’un « Mister je monte, je valide », sans bien sûr que la stigmatisation soit équivalente), moment d’extrême violence. D’une façon plus générale, toutes les dominations se voient ainsi reconduites et exacerbées, sous le couvert de la liberté la plus extrême : dès qu’une personne s’écarte de la norme (et notamment sexuelle), elle est immédiatement en proie à un retour à l’ordre par une stigmatisation de l’ensemble du groupe.
Racismes
Autre écart par rapport à la norme : la politisation. Une énorme stigmatisation touche toute forme d’engagement politique, si bien que certaines personnes en viennent soit à mentir sur leurs appartenances politiques ou à cacher leurs engagements politiques, soit à rentrer dans le jeu de la stigmatisation des groupes politisés. Comme on l’a dit, le Collectif Féministe de l’ENS par exemple se voit, sans aucune forme de préméditation consciente, stigmatisé par un grand nombre des « clubs » du COF , qui se rejoignent dans le procédé d’exclusion : c’est un jeu apprécié de « taper » sur le Collectif féministe, pour être inversement mieux inséré dans les lieux de l’école qui sont tenus par le COF. Ce type d’organisation mettent donc de fait toute forme de militantisme en péril, entravant de façon très efficace leur existence même.
Scène marquante, en première année (avril 2010) : alors qu’à sept heures du matin, l’un-e d’entre nous revenait avec des militant-e-s (tou-te-s blanc-he-s) de l’expulsion des sans-papiers de la rue du Regard (où un piquet de grève était installé depuis plusieurs mois, si bien que les structures militantes du quartier, ainsi que les syndicats de l’école, avaient donné naissance à un comité de soutien), nous avons traversé la cour principale pour rejoindre nos chambres d’internat. Le groupe des « K-Fêteux-ses » de l’époque (tou-te-s blanc-he-s) finissait la nuit dans la cour après une soirée. En nous apercevant, celui qui était alors président du COF nous lance :
« Vous puez le Noir ! ».
Hilarité générale autour de leur table.
L’année dernière, pendant le mouvement social (dont toute forme de sexisme n’était pas absente, soit dit en passant), les militant-e-s de l’école qui soutenaient les personnel-le-s grévistes étaient ridiculisé-e-s en permanence par le groupe majoritaire, notamment par la voie du Bocal. Nous étions notamment rendu-e-s responsables de la fermeture de la cantine de l’école (le « Pot »). Beaucoup parmi celleux qui se plaignaient de ne plus pouvoir déjeuner au Pot avaient oublié de se demander dans quelles conditions travaillaient les personnel-le-s de la cantine avant la grève, et ce qui pouvait bien motiver leur action. Quand le mouvement a pris fin, les travailleux-ses grévistes fêtaient la victoire, tandis que les étudiant-e-s du groupe majoritaire célébraient la réouverture prochaine de « leur » cantine.
La méfiance et l’agressivité vis à vis des groupes politisés permettent et légitiment l’expression d’un racisme et d’un mépris de classe très présents à l’école, et visant notamment les ouvrier-e-s qui y travaillent ou les personnel-le-s de cantine et de ménage, dont beaucoup sont racisé-e-s. Ainsi, quand un peu d’argent a été volé en K-Fêt (ce qui pouvait être le fait de n’importe qui, et par exemple des membres de l’équipe K-Fêt, puisqu’illes ont le privilège le pouvoir passer « derrière le bar »), les ouvriers qui travaillent depuis le début de l’année à la rénovation du lieu ont été accusés par le chef K-Fêt, pendant une AG du COF. Le Collectif féministe a brandi une pancarte « racisme de classe », et a été hué par la salle (environ 200 personnes).
De manière générale, l’état dans lequel sont laissés la cour, les toilettes et les couloirs de l’école après les soirées témoigne d’un profond mépris pour les personnel-le-s de ménage (il arrive que le COF nettoie, quand les soirées ont lieu dans le gymnase, mais la plupart du temps ce n’est pas le cas), qui commencent leur travail au petit matin, moment où certain-e-s étudiant-e-s montent se coucher en jetant dans la cour leur dernière canette de bière, certain-e-s qu’elle aura disparu quand illes se réveilleront.
La Pasteur’s Cup, compétition de football organisée chaque année par le COF en cour Pasteur (d’où le nom), oppose entre elles des équipes composées d’étudiant-e-s. Chacune de ces équipes choisit de « représenter » un pays : c’est un grand moment de racisme (et de sexisme, puisque les buts marqués par des filles comptent double). Or, l’année dernière, pendant que l’équipe « Libye » (entièrement composée de personnes blanches) disputait un match, l’un des joueur-se-s avait jugé spirituel de se déguiser en « terroriste », en portant une djellabah et un keffieh... et quand il avait le ballon, tou-te-s les personnes présentes criaient :
« Oussama ! Terroriste ! Kadhafi ! »
Cela sous les yeux des ouvriers de l’école, tous racisés, qui regardaient le match depuis leurs échafaudages.
Debout !
On voudrait nous faire croire que le sexisme, le racisme, l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie n’ont jamais franchi le seuil de notre école. Pourtant, dans les salles de cours, combien de propos sexistes, racistes, homo- lesbo- bi- et trans-phobes sont tenus par les « intellectuel-le-s » qui sont nos professeur-e-s ? Combien de remarques dans les couloirs, d’agressions dans les soirées ? Le fantasme d’un univers dépourvu de violences n’existe que pour celleux qui en bénéficient. La solidarité de genre, de classe et de race protège les agresseurs de l’ENS comme elle a protégé DSK.
Nos dénonciations ne sont pas calomnieuses. Les personnes qui le prétendent ont intérêt à ce que nous nous taisions. Or, nous sommes féministes, donc déterminé-e-s. Nous ne croyons pas en leurs bons sentiments. Faire émerger tout ce qu’ont de politique ces lieux appréhendés comme privés, et qui semblent n’avoir comme but affiché (et inoffensif) que la fête, c’est se donner les moyens de les combattre politiquement. Les pratiques hétérosexistes et racistes sont ritualisées par les BDE. Depuis que nous les avons publicisées, on nous conseille d’aller porter plainte, comme s’il appartenait aux autres de définir les moyens de notre action. Comme si des personnes pouvaient se « mettre à notre place », et trouver les réponses adéquates qui nous échappent, tant nous sommes troublé-e-s par le traumatisme d’avoir vécu ces agressions. Le déni des dominant-e-s s’accompagne de paternalisme, ce qui rend leur discours un peu bancal :
« Il ne s’est rien passé, mais allez porter plainte au lieu de parler aux journaux. »
On nous conseille d’aller porter plainte, comme si la police et la loi républicaines était des instances neutres et que l’hétéro-patriarcat s’arrêtait aux portes des commissariats et des tribunaux. Comme si les victimes d’agressions sexuelles étaient entendues par l’institution policière, comme si leur parole n’était pas systématiquement mise en doute et moquée. Comme si une personne trans pouvait espérer quoi que ce soit d’une institution qui ne reconnaît pas même son existence. Comme si la République protégeait tou-te-s les individu-e-s des violences qu’illes subissent. Comme si les lieux de pouvoir n’étaient pas tenus par les puissants.


