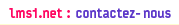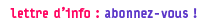Le parcours du migrant est ponctué d’une succession d’attentes. Il y a les attentes programmées comme les années de présence en France pour demander un titre de séjour, il y a les attentes de routine dans les halls ou les salles d’attente de la préfecture ou de l’Ofpra, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, où se rend l’étranger convoqué, il y a les attentes volontaires ou involontaires — consécutives à un dysfonctionnement et/ou à une intention de nuire — comme les rendez-vous à la préfecture sur le Net (qui peuvent s’afficher à 3 heures du matin), ou la remise d’une carte de séjour cinq mois après son émission, il y a aussi les attentes intégrées à la lenteur de la machine administrative comme étant un de ses rouages.
Préliminaires infinis
L’attente est l’état liminaire et permanent de la situation des sans-papiers, qui ne cessent d’attendre le moment où ils pourront acquérir le droit d’accéder au droit — d’avoir des papiers. Avant de parvenir premièrement à l’étape du dossier (son dépôt, son traitement), deuxièmement à la décision de la préfecture, troisièmement à la délivrance de la carte, les étrangers ont dû attendre de satisfaire aux conditions qui les autorisent à entrer dans la phase du projet, le titre de séjour. Attendre le moment où il est légitime d’attendre. Et cette phase, comme les poupées gigognes, en contient d’autres qui ne se découvrent qu’en avançant, ou plutôt qui ne se découvrent qu’au cours d’un surplace obligé qui dure toujours plus longtemps qu’imaginé car elle progresse par scissiparité.
Une fois remplies les conditions de présence en France pour prétendre déposer un dossier, les étrangers qui visent un titre de séjour salarié, les plus nombreux, doivent encore chercher un employeur, qui accepte d’embaucher des sans-papiers et de fournir des bulletins de salaire alors que la loi interdit d’employer des étrangers en situation irrégulière, sous peine d’amende ou d’emprisonnement. C’est un délit.
Idem pour les sans-papiers qui sont interdits de travail mais doivent prouver qu’ils ne sont pas restés oisifs pendant la durée de leur séjour clandestin, en affichant des bulletins de salaire. Il n’est dès lors pas surprenant que les étrangers en situation irrégulière mettent tant d’années, entre cinq et dix ans, à accéder au séjour. Période pendant laquelle ils sont souvent rongés par le stress d’être nulle part, sans logement, sans orient, craignant d’être arrêtés, accumulant des dettes. La future loi a déjà prévu de ne rien changer à cette situation rocambolesque et pernicieuse. Les étrangers doivent montrer qu’ils ont cherché à s’intégrer à la société française par tous les moyens alors qu’on les en empêche par tous les moyens. Donc, soit ils attendent le miracle, soit ils se lancent sur le marché du travail, à leurs risques et périls c’est-à-dire en bravant l’OQTF, obligation de quitter le territoire français (en fait l’espace Schengen).
Des mois et des années s’écoulent avant que l’étranger « sans-papiers » trouve l’employeur ad hoc qui accepte de lui délivrer des bulletins de paye. Il doit guetter pendant des mois et des années l’alignement des planètes, c’est-à-dire que se réalise la concordance de tous les paramètres fixés par l’administration pour tenter d’entreprendre une demande de titre de séjour et qu’au final la hardiesse du patron se conjugue avec la permissivité du préfet. Les agences d’intérim aident à cette entorse à la loi, en engageant des étrangers irréguliers munis d’une carte appartenant à un alias, un ami, un cousin qu’ils vont orienter vers de grosses entreprises qui craignent les contrôles de la police. Moins regardants sur les papiers (mais aussi sur les droits du travail), ces sous-traitants engagent et débauchent sans scrupule, avec la bénédiction des entreprises donneuses d’ordre.
Après les prolégomènes (conditions favorables) commence la procédure administrative proprement dite, dont l’étalement dans le temps semble toujours illimité, car elle couvre la demande de rendez-vous, le dépôt du dossier, son traitement, la décision du préfet, l’impression de la carte, sa communication à l’intéressé, ou si le préfet refuse, la décision accompagnée généralement d’une OQTF. La fin d’une période secouée de trous d’air, d’espoirs douchés, annonce généralement le début d’une autre.
Car la personne qui travaille, et a des bulletins de salaire, n’est pas sûre que le patron lui fera un certificat de concordance le jour où il le lui demandera ; la personne qui travaille à domicile a besoin d’être déclarée par plusieurs personnes, si l’une lâche, le compte des salaires n’y sera pas ; si le couple se sépare, l’époux, le compagnon pacsé ou concubin ne pourra bénéficier du statut de son conjoint en situation régulière ; si le préfet rejoignant l’avis du médecin de l’Ofii estime que l’étranger peut se faire soigner dans son pays, celui-ci devra partir, et bien sûr lui sera parvenue une Obligation de quitter le territoire.
Ces « si » soulignent combien est incertain le futur de l’étranger quand bien même il aura coché toutes les cases. Ces « si » expriment des conditionnalités imprévues, inconnues ; ces « si » signifient que leur vie est actionnée par des facteurs imprévisibles, qu’elle reste arrimée à l’expectative que « ça marche », cette fois-ci. Le chapelet d’attentes subies ruine l’équilibre des personnes obnubilées par la fin d’un tunnel où elles s’asphyxient et dont elles doutent parfois qu’une sortie existe.
L’attente est partout et toujours, elle commence pour la majorité des étrangers devant l’accès au séjour et devant les portes de l’asile pour les autres. Mais les portes ressemblent souvent à des gouffres dont les bords sont fuyants. Pour la procédure d’asile, l’attente est double, attente de convocation et attente de la décision. La longueur de ces attentes est problématique, elle résulte d’un ratio entre le nombre de demandeurs d’asile et le nombre d’officiers d’asile affectés aux dossiers et aux entretiens. En revanche il existe des attentes arbitraires et accablantes, ce sont les mois que doivent attendre les dublinés pour que leur demande d’asile soit requalifiée en procédure normale. Durant cette période d’attente, les étrangers qui demandent l’asile et ne veulent pas retourner dans le pays européen par où ils sont arrivés perdent le droit à l’allocation, à l’hébergement, à la protection santé. Ils peuvent de surcroît être placés en centre de rétention pour être refoulés plus aisément et ne pas échapper à leur destin d’indésirables.
Pourquoi l’attente est-elle une forme récurrente du parcours des migrants ? Parce que le pouvoir « discret » du préfet, parce que la multiplication des contrôles, parce que la défaillance et les ratés des institutions, maintiennent les étrangers à la case départ, les bloquent. Tout en donnant un avis favorable à l’accès au séjour mais en ne leur délivrant pas la carte, tout en accordant le statut de réfugié mais en ne délivrant pas le nouvel état civil, les administrations privent les étrangers de leur droit et souvent leur font perdre leurs acquis. Et ces « incidents » qui retardent la possession du sésame, la carte, se répètent au-delà du sensé. Les institutions administratives se comportent vis-à-vis des étrangers comme si attendre faisait partie de l’intégration, comme si le temps ne leur appartenait pas, ou pas encore, ou jamais tant qu’ils ne seront pas naturalisés et devenus citoyens protégés par la constitution.
Ce temps suspendu qui prive les étrangers de l’exercice de leurs droits n’est nulle part inscrit dans le CESEDA, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est une pratique administrative tolérée par les instances, sinon normalisée, car elle fait partie de la panoplie des moyens qui ralentissent l’intégration des étrangers.
L’attente est une disposition si commune, dans les stratégies de la maîtrise migratoire, que des lieux lui ont été dédiés. Des lieux où on ne fait qu’attendre. Une invention de fou, ou relevant de la psychiatrie ! On connaît les maisons de repos, les salles de contention et d’isolement, mais des zones d’attente fermées pour des personnes qui ne sont pas « malades » et n’ont commis aucun délit, c’est inédit. Moins qu’il n’y paraît puisque des lois datant de la fin du siècle dernier ont transformé l’attente en carcan. Les lois Bonnet et Questiaux de 1980-1981 (les centres de rétention) et la loi Quillès du 6 juillet 1992 (les zones d’attente) l’ont objectivée, lui ont donné des murs et l’ont enfermée à l’intérieur.
En effet, la loi du 6 juillet 1992 a redoublé les mesures de privation de liberté promulguées en 1980, en instaurant des zones d’attente dans les ports et les aéroports destinées aux étrangers qui arrivant en France, n’ont pas les documents exigés pour passer la frontière.
Ainsi dans les années 1980 et 1990 deux espaces fermés sont créés à l’adresse des étrangers que l’État français veut refouler, les uns à l’orée de leur entrée en France, les autres au terme de leur séjour que leur a signifié un arrêté. Leur stipulation est inscrite dans le CESEDA. Outre la séclusion, le régime temporel auquel sont soumis les étrangers de l’une ou l’autre institution est très proche, c’est l’(in)détermination du temps pendant lequel ils sont maintenus ou retenus. (In)détermination retorse faite de temporalités à rallonge appelées par le préfet, faite de dépassements exceptionnels jusqu’au refoulement de l’étranger.