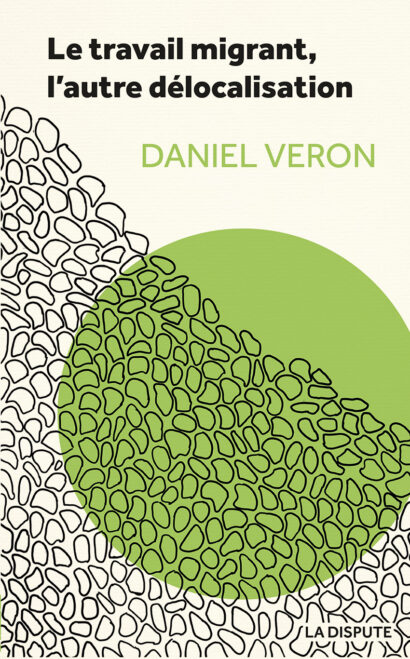
Au long registre des effets révélateurs de la crise sanitaire du printemps 2020, les contradictions du recours au travail migrant figurent en bonne place. « S’ils ne passent pas la frontière, les fraises sont flinguées ! » [2], s’alarmait, au cœur de la pandémie, un maraîcher exploitant, tandis qu’un autre prévenait : « Si on embauche des locaux, on ne va pas sortir nos récoltes ! » [3]. Alors que la fermeture des frontières mondiales stoppait nette l’immense majorité des circulations humaines, le secteur agricole – qui dépend largement du travail de la main-d’œuvre étrangère et dont la saisonnalité rigidifie les contraintes de production – s’est trouvé au bord de la crise. L’Allemagne a ainsi dû décider une levée temporaire et circonscrite de l’interdiction d’entrée sur son territoire pour permettre à 80 000 travailleurs et travailleuses roumain·es de venir sauver la production d’asperges [4]. En Italie, les organisations du secteur ont obtenu la régularisation massive d’étranger·ères sans papiers (jusqu’à 200 000) sous condition de signature d’un contrat dans la filière agricole, malgré les cris d’orfraie de la Ligue du Nord [5]. En France, si le gouvernement a enjoint les travailleurs et travailleuses désœuvré·es par le confinement à s’improviser ouvrier·ère agricole pour aller sauver les récoltes [6], les pouvoirs publics ont semble-t-il surtout fermé les yeux sur les entrées de travailleurs et travaillleuses détaché·es venu·es d’Espagne, souvent latino-américain·es [7].
Cet épisode met en lumière deux caractéristiques fondamentales du fait migratoire : la dépendance des économies capitalistes à un travail fait par des hommes et des femmes venu·es d’ailleurs ; que cette force de travail spécifique n’est pas substituable par du travail « local ». Ce qu’on nommera ici le travail migrant est une forme spécifique d’appropriation du travail humain reposant sur la circulation de celui-ci. Le travail migrant possède donc des propriétés lui conférant un avantage comparatif qui le rend indispensable pour un certain nombre de secteurs des économies capitalistes avancées, friands de main-d’œuvre corvéable et payée au rabais. Quelles sont les conditions sociales et historiques qui rendent possible une sur-exploitation de la force de travail de ces femmes et ces hommes amené·es à traverser les frontières pour vendre leurs bras, leur corps ?
L’ambition de cet ouvrage est de déplier les mécanismes de la production du travail migrant et ses effets sur les subjectivités des travailleurs et travailleuses migrant·es. L’appropriation de leur travail se fait au travers d’une variété de dispositifs institutionnels (statuts migratoires légaux ou non, dispositions réglementaires transnationales, formes particulières d’emploi, accords bilatéraux, etc.) qui permettent la mise au travail des personnes migrantes dans des conditions moins favorables et plus intensives. Les institutions du travail migrant [8] – dont font partie l’illégalisation structurelle des travailleurs et travailleuses migrant·es, les programmes de travail étranger temporaire au Canada, ou le détachement de salarié·es en Europe – correspondent donc à l’ensemble des formes de mise au travail de la main-d’œuvre migrante qui produisent les conditions matérielles d’acceptabilité d’un travail concret dégradé par rapport à un état donné du rapport de classe. À chaque fois, l’avantage comparatif du travail migrant repose sur la production d’un différentiel de prix, c’est-à-dire sur l’exploitation de l’écart entre deux régimes juridiques en matière de droit du travail, de rémunération minimale, de protection sociale, etc. En ce sens, les institutions du travail migrant apparaissent bien comme des modalités particulières de mise en œuvre d’une forme de « délocalisation », mais d’une délocalisation « sur place ».
Délocaliser sur place
La « délocalisation sur place » est une expression forgée par Emmanuel Terray pour désigner l’opération qui consiste, grâce à l’embauche de travailleurs et de travailleuses en situation irrégulière, à offrir aux secteurs dont la production n’est pas délocalisable des avantages équivalent à une opération de délocalisation classique [9]. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, du nettoyage, de la restauration, ou encore des services à la personne, sont par définition ceux dans lesquels la production ne peut être déplacée ; le travail doit nécessairement se faire « sur place ». Dès lors, une stratégie centrale visant à intensifier l’accumulation du capital repose sur un abaissement du prix du travail par le recours à une force de travail « importée », c’est-à-dire à du travail migrant.
Les travaux d’histoire du capitalisme ou d’économie politique ont bien montré que ce type de dispositif s’inscrit dans l’histoire longue des stratégies du capital pour exercer une sur-extraction de plus-value absolue sur certains segments de main-d’œuvre. Cette surexploitation est rendue socialement tolérable en raison de conditions matérielles d’existence des travailleurs et travailleuses en question qui les mènent à accepter des situations dégradées. Karl Marx déjà tenait la nécessité de vendre « librement » sa force de travail pour une condition historique indispensable à la constitution d’un prolétariat. Une condition qui fut remplie par la destruction des commons, c’est-à-dire des modes de vie basés sur l’autosubsistance des communautés paysannes [10]. Yann Moulier-Boutang a par la suite montré avec d’autres qu’en parallèle de la forme classique de l’exploitation décrite par Marx, les stratégies d’exploitation du travail dans la modernité capitaliste sont en réalité diversifiées dès lors qu’on les saisit à l’échelle globale [11]. À côté de ce qu’il nomme le « travail libre dépendant », soit le salariat classique circonscrit d’abord à l’Europe occidentale, on trouve de nombreuses formes de travail non libre, dont le degré de contrainte varie (esclavage, second servage, engagement, apartheid…), soit ce qu’il nomme le « salariat bridé ». L’idée de « bridage » vise à décrire les limites imposées à la mobilité du travail, et en particulier la liberté de fuir – c’est-à-dire de quitter, un employeur, un secteur, un territoire.
Le contrôle de la mobilité du travail est donc un paramètre décisif de l’exploitation capitaliste. Or il suppose à la fois un mouvement d’expulsion et de captation. Expulsion des espaces de vie qui échappent à l’hégémonie marchande ; captation, c’est-à-dire rétention du travail ainsi mis en mouvement dans les espaces de son utilisation. Cette double logique d’expulsion-captation est à l’œuvre aussi bien dans les mobilités internationales que dans les mobilités internes aux États-nations : que l’on pense aux grands mouvements de déplacement des populations noires américaines depuis le Sud esclavagiste vers les grandes cités industrielles au début du vingtième siècle [12] ; à l’expropriation des petits paysans du Midwest vers la Californie pendant la Grande Dépression décrite par Steinbeck dans Les Raisins de la colère, publié en 1939 ; ou encore les populations du Nord-Est du Brésil qui n’ont, depuis le milieu du XIXe siècle, comme rare alternative au péonage dans les plantations de canne à sucre que l’exode vers le Sud industrialisé [13]. Reste que parmi les modalités historiques de bridage du salariat, les différents régimes de la migration internationale occupent une place de choix. Le système des coolies, visant à importer des travailleurs·ses pour l’essentiel indien·nes et chinois·es dans les économies de plantation pour pallier l’abolition de l’esclavage, et plus largement les diverses formes d’engagisme (indentured labour), qui se multiplient à partir du XIXe siècle à travers le globe, sont sans doute pionnières de ces formes de recours à une main-d’œuvre étrangère [14].
Par la suite, l’ensemble de l’édifice des politiques migratoires, qui nait à la fin du XIXe dans la plupart des pays occidentaux, se constitue dans une large mesure autour de cette préoccupation d’un acheminement d’une main-d’œuvre exogène. Exigence capitaliste d’autant plus impérieuse que la classe ouvrière organisée conquiert au même moment de nouveaux droits et de nouvelles protections (réduction de la durée journalière de travail, liberté syndicale, responsabilisation juridique de l’employeur, etc.). Recourir au travail migrant devient dès lors une voie essentielle de leur contournement, ce qui suppose une exclusion du droit commun pour les travailleurs et travailleuses migrant·es. Exclusion du droit commun, mais inclusion au marché du travail dans des formes dégradées. Or cette « inclusion différentielle » [15] suppose un système de justifications de la surexploitation lequel va largement puiser dans les matrices racistes et patriarcales.
Le développement de la migration internationale, après l’esclavage et à côté du fait colonial (et souvent en articulation avec), jette ainsi les bases matérielles nouvelles d’un redéploiement des rapports de domination fondés sur la race mais aussi sur le sexe. « Le racisme vise à garder les gens à l’intérieur du système de travail et non pas à les en expulser ; le sexisme vise la même chose » [16]. Le racisme et le sexisme participent en effet directement de la dynamique de segmentation des marchés du travail par la naturalisation du différentiel de prix entre plusieurs segments de main-d’œuvre [17]. Ce faisant, le travail migrant devient un lieu central de la co-construction des rapports sociaux de classe, de race et de genre.
À l’heure du capitalisme globalisé et de l’internationalisation des chaines de valeur [18], le travail migrant se déploie selon au moins deux modalités distinctes : soit par la mise en concurrence des droits du travail et des systèmes de protection sociale ; soit par le refus du droit au séjour, et donc à une inclusion pleine et entière au droit commun. Dans le premier cas de figure, on retrouve le travail détaché en Europe, et plus largement l’ensemble des pratiques de gestion dite « offshore » de la main-d’œuvre consistant à ancrer tout ou partie de la relation d’emploi dans un cadre déterritorialisé où les droits nationaux peuvent être légalement contournés ; la figure paradigmatique de cette logique est sans doute le principe de « pavillon de complaisance » à l’œuvre dans le secteur maritime [19]. Dans le second, c’est la figure du « sans-papiers », soit la constitution d’un contingent de migrant·es illégalisé·es, qui apparaît emblématique d’une exclusion du droit commun comme ressort d’une surexploitation. Face légale et face illégale d’une même pièce que nous examinerons en détails, on comprend que, dans les deux cas, la frontière, en tant qu’institution, est au cœur de la construction du différentiel sur lequel se fonde la segmentation des marchés du travail.
Seconde Partie, à lire ici.


