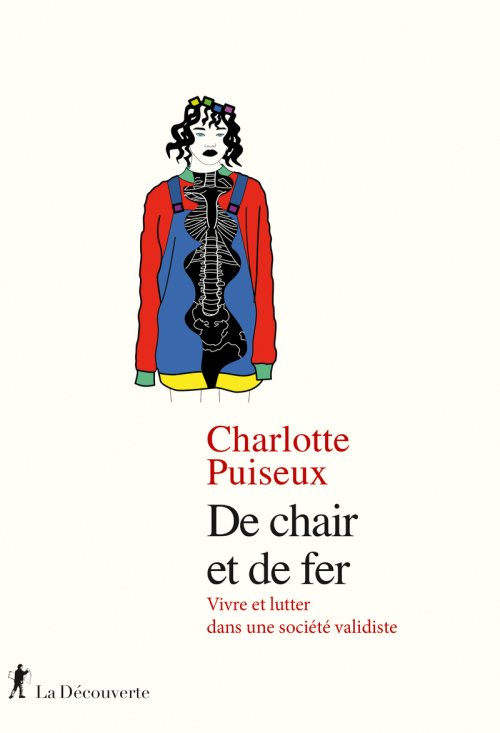Pour ma part, mon handicap trouve son origine dans une maladie génétique. Qui dit maladie génétique pense soins, traitements, hôpitaux, et tout ce qui a trait à la sphère médicale… Mais le terme même de maladie génétique n’est‑il pas à repenser ? Ne contient‑il pas déjà cette vision validiste ? Si une maladie est une altération des fonctions des êtres humains, cela veut dire que moi, qui suis née avec une telle maladie, ne suis pas vraiment humaine ? Je serais donc une humaine ratée, au patrimoine génétique différent, et en l’occurrence inférieur à celui d’un véritable être humain ? Et pourquoi me définir par rapport à un état qui n’est pas le mien, que je n’atteindrai jamais et qui nous est pourtant présenté à toutes comme l’accomplissement ultime de notre humanité ?
C’est donc à cheval entre deux mondes que j’ai grandi : celui dit « normal », peuplé de gens présentés comme valides, et celui des institutions médicales, habité par des personnes handicapées où mon corps n’était perçu que comme malade, à redresser, à rééduquer, à renormaliser. J’ai compris ensuite que ces deux mondes n’en formaient qu’un seul, le second n’étant que la conséquence du premier et de son désir de hiérarchiser les corps.
La réduction « médicale »
La France a une grande tradition du modèle médical du handicap, qui considère que le handicap est le résultat d’un corps individuel défaillant devant être soigné, redressé, guéri et maintenu dans des institutions tant que cela ne se sera pas réalisé. Ce modèle est associé à une vision caritative empêchant les personnes handicapées d’apparaître comme des sujets de droits, égaux à ceux des valides. Pendant des siècles, c’était à la sphère religieuse qu’était dévolue la prise en charge des personnes handicapées. L’assistance, notion empreinte de charité chrétienne, était dès le Moyen Âge portée en partie par les riches, dans le but de gagner leur salut plutôt que dans un véritable souci de celles que l’on nommait alors les « infirmes ». De cette charité sont nées des œuvres, soit des hébergements gérés par un monastère, un évêché ou un seigneur. Les confréries religieuses, soutenues par des bienfaiteurs, ont créé les premiers hôtels‑Dieu où se mélangeait toute la misère sociale, y compris celle liée au handicap.
La conception française actuelle du handicap est toujours fortement imprégnée de cette histoire, et ne se défait que très difficilement des modèles caritatif et médical. Il n’y a qu’à lire, à ce sujet, la dénonciation de cette politique française par la rapporteuse de l’ONU en 2017 :
« Durant mon séjour, de nombreux interlocuteurs chargés du handicap ont exprimé leur point de vue selon lequel les personnes handicapées devraient bénéficier de services spécialisés distincts, notamment dans le cadre d’établissements résidentiels, de façon à leur fournir les meilleurs soins, les protéger de toute atteinte, stigmatisation ou discrimination éventuelles, et assurer leur sécurité en compagnie de leurs pairs handicapés. Conformément à ce point de vue, les tentatives actuelles pour répondre aux besoins des personnes handicapées sont extrêmement spécialisées, isolées et cloisonnées. L’accent est mis sur la déficience de l’individu et non pas sur la transformation de la société et de l’environnement pour assurer des services accessibles et inclusifs ainsi qu’un accompagnement de proximité.
Non seulement ce type de réponse isolée perpétue la méprise selon laquelle les personnes handicapées seraient “objets de soins” et non pas “sujets de droits”, mais il accentue leur isolement face à la société. Il entrave et/ ou retarde également les politiques publiques visant à modifier l’environnement de façon radicale et systématique pour éliminer les obstacles, qu’ils soient physiques, comportementaux ou liés à la communication.
À mon sens, la France doit revoir et transformer son système en profondeur afin de fournir des solutions véritablement inclusives pour toutes les personnes handicapées, assurer une gestion et une répartition plus efficaces des ressources, et permettre un accompagnement et des services spécialisés de proximité sur la base de l’égalité avec les autres. Pour prendre ce virage, la France doit faire siens l’esprit et les principes de la CDPH, en adoptant une politique du handicap fondée sur les droits de l’homme. Cette démarche devrait imprégner tous les programmes, orientations, stratégies et solutions à tous les niveaux, du local au national, de façon à transformer la société dans son ensemble et rendre tous les droits de l’homme inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. » [1]
C’est au cours du xxe siècle que s’est développé le modèle médical, en lien avec les avancées scientifiques, mais aussi avec l’accroissement de l’industrialisation et la Première Guerre mondiale. Ces deux événements majeurs ont contribué à accroître considérablement le nombre de personnes handicapées, en multipliant d’abord les accidentés du travail, victimes de cette industrialisation dévorante, puis avec les très nombreux mutilés de guerre revenus du front. La nation, poussée par la culpabilité, s’est alors engagée à soigner, rééduquer, redresser ces corps dans des centres spécialisés pour leur donner une seconde chance, pour leur permettre de revivre normale‑ ment au sein de la cité. Ce modèle a ensuite été appliqué à toutes les personnes déviant de la norme valide, qui se sont alors vues enfermer en vue d’être « sauvées », entourées de médecins afin d’être guéries, et reléguées dans des institutions mouroirs si le sauvetage se trouvait compromis.
Le cœur de ce modèle médical est de percevoir le handicap comme un destin individuel, une expérience qu’un être fait de ses propres incapacités par rapport aux normes attendues de la validité. Le corps handicapé est, dans ce cadre, inévitablement un corps raté, dysfonctionnant, et cet état de fait trouve son assise dans une réalité biologique propre à la personne qui en est porteuse, attestée selon la médecine validiste.
Cette idée du corps handicapé comme anomalie a atteint peut‑être son paroxysme lors des exterminations nazies de la Seconde Guerre mondiale puisque les personnes handicapées ont été une des populations les plus touchées par le génocide. Stérilisations forcées, exterminations dans les chambres à gaz, famines, injections médicamenteuses, ces massacres aussi ont été commis au nom de la préservation de la « pureté de la race ». Ils ont notamment été perpétrés dans les centres fermés, asiles, hôpitaux ou prisons, ciblant les personnes ayant des problèmes psychiques, mentaux, neurologiques ou des paralysies incurables, celles hospitalisées depuis plus de cinq ans, et celles jugées comme « aliénées criminelles ». Isolées aussi bien géographiquement que socialement, elles étaient les candidates idéales.
Le IIIe Reich a adossé ces exterminations à des campagnes idéologiques, arguant du fait que prendre soin des personnes handicapées n’était que pure perte d’argent pour le pays et empêchait d’investir en vue de favoriser le développement des conditions de vie des personnes valides qui, elles, étaient efficaces et productives. Certains ont même invoqué la charité pour justifier le meurtre des personnes handicapées, l’associant à une forme de libération pour ces individus à la vie indigne…
Le programme officiel d’extermination des personnes handicapées est nommé Aktion T4, en référence au numéro du bureau d’où étaient dirigées les opérations, et est également connu sous la dénomination de « programme d’euthanasie ». Ce programme est lancé en janvier 1940 et s’achève officiellement en août 1941, bien que les tueries se poursuivent après cette date. Les asiles, les institutions d’aide sociale, les maisons de repos continuent d’informer les autorités nazies par l’envoi de formulaires dénonçant les personnes ciblées et ces mêmes autorités continuent d’organiser l’acheminement vers les camps d’extermination. Des euthanasies sont également pratiquées localement, notamment par injections médicamenteuses, ou même par famine. Au total, entre 200 000 et 250 000 personnes handicapées ont été assassinées par le régime nazi.
Éliminées physiquement comme ce fut le cas dans les camps, mais aussi socialement de l’espace public comme c’est encore une réalité aujourd’hui, les personnes handicapées sont pourtant trop souvent ramenées au tragique de leur destinée personnelle, dédouanant la société de ses responsabilités dans les difficultés qu’elles rencontrent. Le vote de lois stigmatisantes, tel que le report en 2015 de l’obligation d’accessibilité des lieux publics, ou la loi Élan de 2018 qui réduit de 100 % à 10 % le parc de logements neufs accessibles, sont de réelles prises de position politiques allant vers un isolement et un rejet des personnes handicapées. Cette réalité prouve encore une fois la nécessité de repenser le handicap en termes politiques et de le sortir définitivement du modèle médical qui l’a bien trop longtemps défini.
Les analyses sociopolitiques
À partir de cette mise en perspective, un champ immense de découvertes allait alors s’offrir à moi : celui des disability studies, les études sur le handicap… Très peu connu en France, le modèle social du handicap sur lequel elles s’appuient a été pour moi une véritable révélation. J’ai pris connaissance des écrits de Mike Oliver [2], militant handicapé et sociologue britannique, premier professeur en disability studies et pionnier de ce modèle, qui a mis en avant le fait que le handicap est avant tout une affaire d’institutions, qu’il se construit en lien avec des structures sociopolitiques et économiques, et que la discrimination subie par les personnes concernées est à combattre au même titre que le sexisme ou le racisme. Oliver a également insisté sur le rôle du capitalisme qui d’un côté utilise le modèle médical du handicap pour sortir les personnes handicapées du monde du travail et, de l’autre, les stigmatise encore plus en réduisant considérablement les services publics.
Lors d’un voyage à Londres, j’ai rencontré Roddy Slorach, universitaire et militant handicapé, qui s’intéresse lui aussi aux liens entre capitalisme et handicap, et dont j’ai traduit quelque temps plus tard un article passionnant pour une revue du NPA [3]. Il y décrit clairement la création sociale du handicap, notamment à la lumière de la montée du capitalisme dès la révolution industrielle et jusqu’à la société néolibérale des années 1990‑2000, retrace le mouvement pour les droits civiques des personnes handicapées, sa montée et son déclin, et aborde les notions d’oppression et de classe à l’aune du handicap.
À partir de toutes ces réflexions, je comprenais que le handicap pouvait être analysé comme une expérience collective issue d’une interaction entre une personne et son environnement et que ce dernier était un facteur extrêmement important de création du handicap. Il n’était plus uniquement localisé dans le corps de la personne mais dans le manque d’adaptation de la société qui n’était pas pensée pour répondre aux besoins de toutes ses membres. Ces idées ont émergé dans les années 1970 aux États‑Unis et au Royaume‑Uni chez des militantes considérées comme lourdement handicapées physiquement, tel Ed Roberts. Ce mouvement s’est notamment développé au sein de certaines universités étatsuniennes, comme Berkeley, haut lieu de la contestation, où les étudiantes handicapées ne voulaient plus être condamnées à vivre en institution et ont développé le concept de « vie autonome ». Celui‑ci est au cœur du mouvement du même nom (Independent Living) qui s’est progressivement étendu et internationalisé. Au Royaume‑Uni, c’est notamment à travers l’Union of the Physically Impaired Against Segregation (Upias), apparenté à un syndicat, que le mouvement s’est développé, porté par des noms comme Vic Finkelstein ou Mike Oliver.
Ce mouvement défendait ainsi l’idée selon laquelle le handicap est une création sociale car la communauté choisit sciemment d’exclure de son fonctionnement une certaine catégorie d’individus. Ce modèle social a par la suite été critiqué, accusé de retirer totalement la dimension corporelle du handicap, comme l’explique le militant handicapé anglais Tom Shakespeare :
« Le modèle social s’oppose si fortement aux approches individuelle et médicale qu’il risque d’induire que la déficience n’est pas un problème. Tandis que d’autres représentations sociopolitiques du handicap ont développé l’idée importante que les personnes ayant une déficience sont aussi bien handicapées par la société que par leur corps, le modèle social suggère que les personnes sont handicapées par la société et non par leur corps. En s’opposant simplement à la médicalisation, il peut être interprété comme un rejet de la prévention médicale, de la rééducation ou du traitement de la déficience, même si ce n’est pas ce que disent l’UPIAS, Finkelstein, Oliver ou Barnes. »
Ce retrait de la dimension corporelle est ressenti comme injuste par de plus en plus d’activistes dont le corps est une réelle source de souffrance, de fatigue ou de symptômes qu’aucune adaptation de l’environnement ne peut soulager. Le modèle social représente cependant un changement majeur de paradigme dans l’histoire de la compréhension du handicap, et les critiques qui lui sont adressées permettent de l’affiner encore davantage. À travers ces contestations, il ne s’agit pas de revenir au modèle médical du handicap qui est une vision validiste des êtres et de leurs aptitudes. L’enjeu est de permettre aux personnes handicapées de se soigner, d’avoir accès à une médecine bienveillante qui prenne en compte leur souffrance, tout comme elle est censé le faire pour tout un chacun.
Deuxième extrait : Le-mythe de la capacité
Troisième extrait : Usages langagiers, pratiques militantes : l’impensé validiste