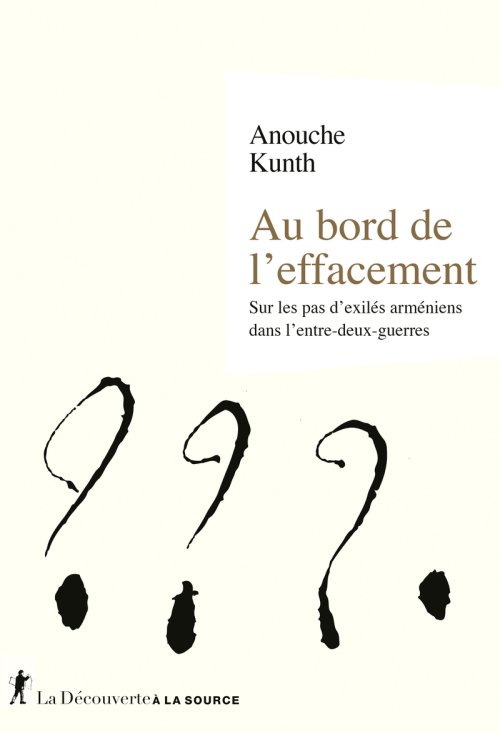Aussi, dans mes notes, la liste « Décès prématurés » vient- elle s’associer, vertigineuse, à celles portant sur les conditions de vie ; des pages entières font le relevé des disparitions précoces, survenues en France des suites d’une maladie, d’un accident du travail, plus rarement d’un meurtre. Tirés de la seule boîte 5, ces quelques aperçus :
Siranouche perd en 1932 l’homme qu’elle a épousé en 1926. Il décède à l’hôpital marseillais de la Conception. Leur fille Sarah a vu le jour à Paris en 1929.
Arakel épouse à Marseille, le 27 juillet 1933, une femme qui décède un an plus tard, le 16 juin 1934.
Haiganouche Raphaëla épouse en janvier 1928 un homme qui décède à Marseille en mai 1929. Elle est veuve à vingt-et-un ans.
Marie décède en 1933. Elle laisse à son mari – épousé à Marseille en 1929 – et à ses deux enfants en bas-âge, Jean Marcel et Jeanne, la somme de 4 070 francs et 41 centimes.
Ohanès épouse à Marseille en 1927 une femme née en 1911 à Arabkir. Elle meurt en 1932. Elle a vingt-et-un ans.
Giraïr, né en 1920, perd d’abord sa mère à Marseille, puis son père en 1932. Étant à douze ans le plus âgé de la fratrie, il est le porteur d’un certificat destiné à récupérer les objets, effets, papiers d’identité que son père a laissés à La Conception. Puisse « l’Administration de l’Hôpital » permettre à l’Office « de régulariser la situation de ces deux pauvres orphelins de père et de mère. »
Comment ne pas entendre la portée heuristique du « cri d’alarme » que jetait Krafft-Bonnard sur le sort des exilés [1], sur l’inquiétante morbidité qui les frappait « dans nos pays » – il insiste – et non plus seulement là-bas, en Grèce par exemple, dans les camps de réfugiés ?
Question délicate, que les morts différées, dès lors qu’elles surviennent dans une temporalité distincte de celle des massacres – à bas bruit, dans une chambre d’hôpital ou d’hôtel, de toute évidence au contact prolongé de la misère et de ses privations : une traversée fatale du dénuement, que font également bien des tubards. Certaines morts, pourtant, portent la marque singulière du génocide. À Marseille dans les années 1930, des Arméniennes meurent à l’asile Saint-Pierre de « paralysie générale », appelée encore « méningo-encéphalite ». Les médecins psychiatres constatent l’évolution démentielle de la maladie, sans en expliciter l’origine bactérienne. Or les symptômes correspondent au stade ultime de la syphilis, dont les phases de développement suggèrent, par déduction, une infection initiale durant le génocide. Les violences sexuelles s’accomplissent dans ces morts lentes.