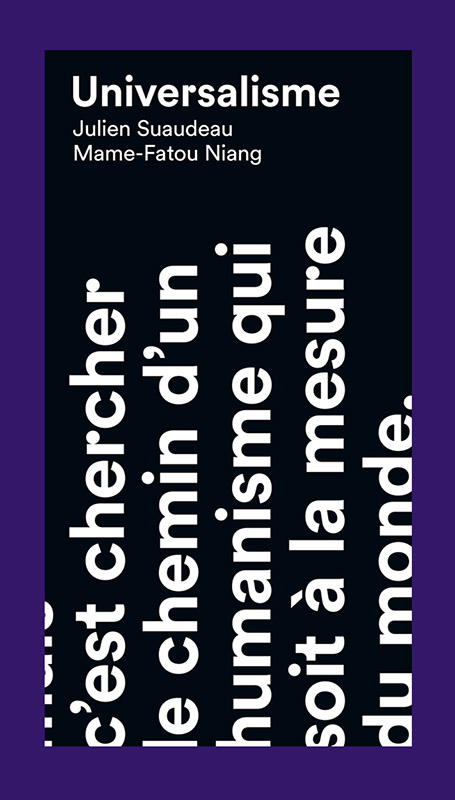Gommer de l’espace public tout en clamant haut et fort son intention de témoigner – ainsi va la mémoire-fantôme prescrite par le pseudo-universalisme pour ne pas regarder le passé en face ni en tirer les conclusions dans le présent. Le déni n’est pas seulement historique ; il est aussi géographique. Pourquoi, dans un pays aussi centralisé que la France, les principaux mémoriaux de la traite transatlantique et de l’esclavage sont-ils installés à Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Pointe-à-Pitre ? Ces villes étaient, bien sûr, les charnières du commerce négrier. Mais où, sinon à Paris, le projet colonialiste a-t-il été conçu, imaginé, négocié entre les différents acteurs de l’État au XVIIe siècle ? Où, sinon à Paris, a été prise la décision de créer les compagnies maritimes qui se sont succédé pour le mener à bien ? Comment expliquer, à la lumière de la culture jacobine qui imprègne le fonctionnement de nos institutions, que la mémoire de ces crimes contre l’humanité continue à être repoussée loin de la capitale ?
Reléguer les lieux de mémoire à la périphérie, au fond, c’est organiser l’irresponsabilité et l’immunité historiques. Ici culmine l’hypocrisie pseudo-universaliste : il s’agit, non plus de nier l’histoire, mais de désamorcer l’actualité et la possibilité d’un racisme made in France, autrement dit la continuation de la violence et du préjudice coloniaux sous d’autres formes, notamment les violences institutionnelles et policières contre les minorités.
« Même un Noir français, selon l’écrivaine Tania de Montaigne, n’a aucune idée de ce que c’était que d’être noir à Montgomery au temps de la ségrégation. » D’où viennent cette fausse naïveté, ce besoin d’extrader un problème qui a son histoire française ? James Baldwin le rappelait devant une caméra de l’ORTF et en français dans le texte :
« L’idée de la suprématie blanche n’est pas née là-bas (en Amérique). Elle est née ici (en Europe) ».
Si l’importation du racisme américain est un poncif fallacieux et vide de sens, l’exportation du racisme européen est un fait historique : le racisme, dans les pays que sont devenus les grands empires coloniaux, est un effet-boomerang, un retour à l’envoyeur cinq siècles après. La pensée pseudo-universaliste, elle, considère le racisme comme un objet neutralisé – un colis suspect sous sa cloche, qui ne risque plus de nous faire du mal. C’est un monstre ancien que la République, droits de l’Homme en étendard, a terrassé il y a longtemps sur le territoire national. Conséquence de cette mise à distance : l’antiracisme est vu comme une position constructive uniquement quand il n’a pas de dimension hexagonale ni contemporaine. Combien de parcs, de stations de métro, de rues, de centres de loisirs portent le nom de Martin Luther King ? Rosa Parks ? Nelson Mandela ? Voilà de dignes héros antiracistes. James Baldwin. Marielle Franco. Pourquoi ? Parce que ces gens ont combattu un système d’oppression et l’idéologie de la suprématie blanche aux États-Unis, en Afrique du Sud ou au Brésil – loin d’ici. Appliqué à la France, où le racisme n’aurait pas d’historicité, l’antiracisme devient une lubie toxique, une maladie infantile de l’intellectuel, de l’universitaire ou de l’artiste. Pourquoi le racisme français demeure-t-il un impensé, objet d’un malaise diffus et de multiples refoulements historiques et linguistiques ?
Deux outils sont essentiels pour comprendre ce qui se joue dans ces rapports entre la société majoritaire et ses composantes minoritaires « hyper visibles », qu’on feint de ne pas voir : l’ancrage et l’imaginaire. Le lexique du débat public est saturé d’emprunts : woke, cancel culture, mots devenus des signifiants fourre-tout, saturant l’espace médiatique et symbolique aux dépens des problématiques indigènes. Black face. Philippe Torreton grimé en noir pour jouer Othello, Gérard Depardieu charbonné pour camper Dumas : autant d’occasions manquées d’interroger la place des acteurs non blancs en France. Pourquoi faut-il encore aujourd’hui barbouiller un Blanc pour faire le Noir, Noir à qui on répète audition après audition que le rôle du voyou ayant déjà été distribué, il n’y a plus de rôle pour lui ? Pourquoi parler de black face alors que la pratique désignée par cette expression renvoie aussi à une tradition bien de chez nous, le barbouillage ? Pourquoi ne dit-on pas « Afro-français » ? Pourquoi le mot « noir » est-il si embarrassant qu’on lui préfère souvent, au pays de l’exception culturelle, black ?
Cette mise à distance systématique a un corollaire dans le monde de la recherche et de l’enseignement : la disqualification d’approches critiques et théoriques remettant en cause la mythologie républicaine d’une France post-raciale, « colorblind ». En 2020, le ministre de l’Éducation nationale évoque « une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles, qui veulent essentialiser les communautés et les identités, aux antipodes de notre modèle républicain ». Sartre, Lacan, Derrida, Kristeva, Foucault, Deleuze ? Le ministre a peut-être lu ces piliers de la French Theory. Mais a-t-il entendu parler de La Revue du Monde Noir ? Connaît-il Paulette Nardal, première étudiante noire à la Sorbonne qui, dans les années 1930, tient salon dans sa maison de Clamart, où se retrouvent artistes, étudiants et travailleurs d’Afrique et des Antilles, mais aussi des femmes qui débattent de leur position dans des mouvements balbutiants sur le point de donner naissance à la Négritude ? Que lui évoque l’œuvre de l’écrivaine cayennaise Roberte Horth, consacrée aux expériences noires dans le Paris de l’entre-deux-guerres ? Au nom de quel étrange anathème le nom de ces femmes devrait-il être expurgé des dictionnaires d’auteurs français ?
Ce que nous enseigne James Baldwin, sa grande pertinence aujourd’hui, c’est que l’innocence pseudo-universaliste, de ne pas être comptable, constitue l’ultime avatar du privilège blanc, ce droit naturel à l’indifférence qui est le legs de la domination. Les progressistes blancs, Baldwin l’écrit au début de The Fire Next Time (La prochaine fois le feu), pensent qu’ils ne sont pas responsables des crimes de leurs ancêtres. Ces innocents sont d’accord pour envisager le racisme comme un mal extérieur : s’il existe encore, ce mal ne les concerne pas – commodité du mal qui n’est pas nous. Faire face au racisme en tant qu’objet organique, partie de nous-même, est inacceptable. Regarder les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Polynésiens de France non seulement comme des égaux, mais aussi comme les héritiers du viol colonial, est irrecevable. Mettre en avant la version non expurgée de l’Histoire, rappeler selon quelles sinistres modalités a eu lieu le « contact » entre l’Europe et l’Afrique, puis les Amériques, puis les autres parties du monde, c’est culpabiliser, jeter le mauvais œil, empêcher d’avance.
Questionner notre innocence, quitter l’état d’innocence, c’est aussi se faire violence. Comment imaginer une France réellement postcoloniale, un universalisme non biaisé, sans ouvrir la réflexion sur les angles morts que notre bonne conscience insère dans le récit historique ?