Partie précédente : les années 1970 et 1980.
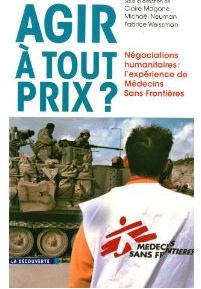
Avec la fin de la guerre froide, le témoignage public et la défense des droits humains commencent à acquérir une certaine légitimité au sein des quatre autres sections de MSF. Créées au cours des années 1980 en Belgique, en Hollande, en Espagne et en Suisse, elles s’étaient jusqu’alors résolument opposées à la pratique française du témoignage, accusée de politiser MSF en violation de ses statuts. Au terme d’âpres discussions, l’ensemble des sections décide en 1992 de supprimer les dispositions de la charte engageant les membres de MSF à un strict devoir de réserve et leur interdisant toute immixtion dans les affaires intérieures d’un État. Aussi, retracer l’évolution des prises de parole à partir des années 1990 n’est pas aisé, tant les messages sont multiples, évolutifs, contradictoires, fortement influencés par les expériences de terrain et objets de virulentes polémiques à l’intérieur du mouvement. Nous en donnerons une lecture sélective principalement tirée des expériences de la section française.
Au cours des années 1990, les camps de réfugiés tendent à disparaître et l’aide humanitaire à se déployer à l’intérieur des zones de conflits. Aux missions clandestines menées sous la protection d’une guérilla succèdent des projets de plus grande envergure qui nécessitent l’accord de plusieurs belligérants. Ces derniers sont particulièrement nombreux dans les pays tels que la Somalie et le Libéria, ou, à l’instar des gouvernements irakien, birman et soudanais, foncièrement hostiles à l’intervention d’ONG occidentales. Alors qu’elle n’a jamais été aussi présente au cœur de la guerre, MSF estime, en 1992, que « le principal problème aujourd’hui est celui de l’accès aux victimes : les autorités ou les factions s’opposent à l’action humanitaire, témoin gênant de leurs exactions, et l’insécurité rend l’intervention de plus en plus périlleuse14 ».
Face à ces difficultés, MSF doit compter avec les ressources et les contraintes associées à une nouvelle forme d’internationalisation des conflits. Durant les cinq années qui suivent la première guerre du Golfe (1990-1991) – présentée par l’administration américaine comme l’acte inaugural d’un « nouvel ordre mondial » –, le Conseil de sécurité des Nations unies lance vingt-quatre missions de maintien de la paix, autant que pendant les quarante-cinq premières années de son existence. Établissant un lien entre les atteintes à la paix et les violations du droit international humanitaire, l’ONU autorise le recours à la force pour sécuriser les opérations d’assistance dans le Kurdistan irakien, en Somalie et en Bosnie notamment. Alors que, traditionnellement, les médecins humanitaires escortaient les armées, « ce sont à présent les armées qui escortent les volontaires des organisations humanitaires15 », observe avec perplexité MSF en 1993.
Néanmoins, ses dirigeants accueillent favorablement l’implication croissante de l’ONU et des États occidentaux dans les conflits. Le totalitarisme soviétique vaincu, les États démocratiques et l’ONU auraient plus que jamais un « rôle essentiel à jouer [...] pour obtenir un réel accès aux victimes et faire cesser les violations des droits de l’homme16 ». Cependant, MSF multiplie les interpellations à l’adresse des gouvernements occidentaux et de l’ONU, elle critique tout particulièrement les interventions militaires se donnant pour mandat de protéger les acteurs humanitaires. Celles-ci ne permettent pas toujours d’améliorer l’accès aux victimes. Mais, surtout, elles constituent un « alibi » permettant aux puissances occidentales de se défausser de ce qui est, selon MSF, leur responsabilité première : lutter contre les violations massives des droits humains, y compris par des moyens militaires.
C’est à propos de l’intervention internationale en Irak que MSF développe pour la première fois sa critique de l’« alibi humanitaire ». Profitant de l’ébranlement du régime irakien au sortir de la première guerre du Golfe, les populations kurdes et chiites se soulèvent en mars 1991, avant d’être écrasées par la garde républicaine, qui pousse plus d’un million de Kurdes à l’exode. Les déplacés s’entassent aux frontières iranienne et turque, suscitant les inquiétudes d’Ankara, qui craint une arrivée massive de Kurdes dans les provinces où son armée combat déjà une insurrection. Le 5 avril 1991, le Conseil de sécurité condamne la répression des populations kurdes et demande à l’Irak de faciliter l’accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d’assistance. Français et Américains engagent leur armée dans une vaste opération de secours et de rapatriement (« Provide Comfort »), techniquement réussie, à laquelle participent une soixantaine d’ONG, dont MSF. Pour autant, celle-ci critique le cynisme avec lequel les États occidentaux, après avoir encouragé les Kurdes et les Chiites à se révolter, les auraient laissés se faire massacrer. Du point de vue de MSF, « Provide Comfort » sert à « enjoliver l’échec partiel d’une guerre du Golfe incapable de venir à bout de Saddam Hussein17 ».
Implicite dans le cas du Kurdistan, la condamnation de l’humanitaire d’État comme alternative à la guerre contre des pouvoirs criminels est au cœur de la campagne d’opinion menée par MSF durant la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995). À l’origine d’au moins 60 000 morts18, le conflit entraîne le déplacement de deux millions de personnes, soit la moitié des habitants. Induits par des pratiques de terreur (massacres, incendies de village, exécutions, viols, internement...), les transferts de population ne sont pas une conséquence indirecte de la guerre, mais l’un de ses principaux enjeux. Les partis nationalistes croate, musulman et serbe (ce dernier bénéficiant d’une supériorité militaire grâce au soutien de l’armée yougoslave) défendent chacun un projet plus ou moins radical d’homogénéisation ethnique des territoires qu’ils revendiquent.
Dans ce pays d’Europe centrale doté d’un système de santé moderne et d’un personnel médical qualifié, les interventions médicales de MSF sont d’une utilité marginale. L’action de l’association se concentre principalement sur l’assistance aux déplacés et l’approvisionnement médical des enclaves musulmanes encerclées par les forces bosno-serbes. « Au-delà de l’assistance matérielle, nous envisagions la présence dans ces villes assiégées comme un acte symbolique : la nécessité d’être témoins », souligne rétrospectivement Pierre Salignon, membre de la mission de MSF-France en Bosnie19.
Témoins de l’asphyxie des enclaves où s’entassent des milliers de déplacés exposés au feu des snipers et des artilleurs serbes, connaissant l’existence de camps d’internement civils, ainsi que les méthodes terroristes utilisées par les miliciens pour chasser les populations, les équipes de MSF n’entendent pas rester neutres entre assiégeants et assiégés, déportés et organisateurs des déportations. Dès le mois d’avril 1992, puis lors de la visite en juin du président français François Mitterrand à Sarajevo, qui explique que l’engagement de la France et de l’ONU se limitera à la protection des secours humanitaires, les responsables de MSF multiplient les déclarations à la presse. Ils dénoncent la « passivité de la communauté internationale » et plus particulièrement des États européens face à la « purification ethnique » en Bosnie. Pour MSF, l’homogénéisation ethnique des territoires à laquelle procèdent les miliciens serbes manifeste la résurgence du totalitarisme génocidaire au cœur de l’Europe. C’est pourquoi elle juge l’action humanitaire menée par les ONG dérisoire, si ce n’est complice, en raison de son « rôle d’accompagnateur, voire d’auxiliaire », d’une politique criminelle20. À ce titre, la section française suggère, en 1992, à l’ensemble du mouvement de stopper toute opération en Bosnie. « Ce sont les collines de Sarajevo qu’il faut bombarder. Il faut déclarer la guerre aux nationalistes serbes21 », déclare Rony Brauman sur les ondes de RTL en avril 1992.
Outre la mobilisation du spectre génocidaire, MSF ancre son appel aux armes dans le droit international humanitaire. Ainsi, en novembre 1992, les équipes réalisent une enquête, la première du genre, auprès d’une soixantaine de réfugiés bosniaques accueillis en France. Cherchant à retracer l’histoire de leur fuite et à qualifier juridiquement les violences auxquelles ils ont survécu, le rapport sur « le processus de purification ethnique dans la région de Kazarac » conclut que « les exactions commises par les Serbes de Bosnie-Herzégovine ne relèvent plus seulement des violations de droits de l’homme ou du crime de guerre mais d’un crime avéré contre l’humanité, selon la définition du Tribunal de Nuremberg ». Le rapport est diffusé à la presse ainsi qu’à de nombreuses institutions, comme le Congrès américain, et au rapporteur spécial de l’ONU pour la Yougoslavie. L’appel aux armes prend ici la forme d’un appel à une « opération de police internationale [...], les États ont le devoir de faire cesser, par tous les moyens possibles, les violations graves du droit humanitaire22 ».
En exigeant des gouvernements occidentaux qu’ils fassent la guerre aux régimes oppresseurs au lieu de protéger les opérations de secours, MSF s’engage dans le débat public aux côtés des courants néoconservateurs et internationalistes libéraux. Depuis la chute du mur de Berlin, ces derniers affirment avec insistance qu’il est de la responsabilité et dans l’intérêt des démocraties libérales d’user de leur puissance militaire pour défendre les droits humains à l’extérieur de leurs frontières. De manière surprenante, l’engagement probosniaque de MSF ne semble pas provoquer de représailles directes de la part des milices serbes, avec lesquelles elle doit négocier sa présence en ex-Yougoslavie. En revanche, la rhétorique néoconservatrice qu’elle contribue à amplifier est vertement critiquée par des spécialistes de la Bosnie-Herzégovine comme un facteur de radicalisation du conflit. Les appels aux armes, désignant le nationalisme serbe comme une version contemporaine du nazisme, encourageraient l’escalade militaire et le recours à des stratégies victimaires par les partis nationalistes croate et musulman, soupçonnés d’exposer délibérément leur population pour provoquer le soutien armé de l’Occident23.
Somalie, Rwanda : les limites de l’interventionnisme libéral
L’engagement interventionniste de MSF est néanmoins ébranlé en Somalie, où l’association constate que le remède militaire international peut s’avérer pire que le mal. Les troupes américaines et onusiennes, qui débarquent à Mogadiscio en 1992-1993, ont pour principal mandat de sécuriser les opérations de secours humanitaires dans un contexte de famine et d’insécurité généralisées. L’arrivée des forces étrangères suscite des réactions mitigées de la part de MSF. La section belge se montre officiellement favorable, car elle y voit le moyen d’accéder aux zones rurales, de « garantir [aux humanitaires] une protection plus efficace », ainsi qu’« un arrêt du cercle vicieux qu’est le paiement des milices ». Confrontée à l’effondrement de l’État et à la privatisation de la violence, MSF est en effet contrainte de louer les services de gardes armés mis à disposition par des chefs de guerre, ainsi directement financés par l’association, ce qui suscite des critiques de la part de journalistes ou de volontaires. Les sections française et hollandaise sont en revanche plus sceptiques face au débarquement très médiatique des troupes internationales. Elles estiment que la stratégie de dialogue et de négociation adoptée jusqu’alors par le représentant spécial des Nations unies est plus à même de créer les conditions favorables à l’expansion des activités de secours.
Dans les premiers mois de 1993, le déploiement international permet de multiplier les distributions de nourriture à l’intérieur du pays, contribuant ainsi à endiguer la famine déjà sur le déclin. Mais rapidement, les forces internationales se transforment en partie en conflit responsable de nombreuses exactions : bombardements d’hôpitaux et de locaux d’organisations de secours, torture et assassinat de non-combattants, massacres de civils. Assimilées aux forces internationales, les organisations humanitaires sont prises pour cibles par les factions auxquelles l’ONU et les États-Unis ont déclaré la guerre. La section française se retire du pays en 1993, dénonçant la « confusion militaro-humanitaire » qui l’expose, et le retournement de la logique humanitaire : « Pour la première fois, en Somalie, on a tué sous la bannière de l’humanitaire24. » MSF en conclut que la protection armée internationale est un piège. Face à l’effondrement de l’État, l’horizon politique d’une intervention militaire ne peut être qu’une mise sous tutelle internationale – projet aux relents coloniaux, dont le coût politique et financier empêche d’envisager la réalisation, estiment alors les dirigeants de l’association25.
À l’issue de l’expérience somalienne, MSF esquisse une première critique publique de l’interventionnisme militaire international. Elle en souligne les limites, les possibles dérives criminelles, ainsi que ses effets pervers sur les acteurs de secours assimilés aux militaires chargés de les protéger. Ces réserves seront balayées devant la gravité exceptionnelle de la crise qui ravage la région des Grands Lacs en Afrique centrale entre 1994 et 1997.
D’avril à juillet 1994, la population tutsie est systématiquement pourchassée et exterminée au Rwanda. Active dans plusieurs villes du pays, MSF prend progressivement conscience du caractère génocidaire des massacres. Alors que le génocide est délibérément nié par les membres du Conseil de sécurité des Nations unies, décidés, pour des raisons diverses, à ne pas intervenir, MSF lance, pour la première fois de son histoire, un appel explicite à une intervention armée internationale contre un régime qui pratique « l’extermination planifiée et méthodique d’une communauté26 ». Au second semestre 1994, MSF s’élève contre la reconstitution de l’administration génocidaire dans les camps de réfugiés rwandais au Zaïre et en Tanzanie, qui accueillent près de 2 millions de personnes. Alors que le secrétaire général des Nations unies ne parvient pas à réunir les forces nécessaires pour neutraliser le réseau génocidaire, MSF interpelle l’ONU et les puissances occidentales afin qu’elles démilitarisent les camps, qu’elles en assurent la police et qu’elles arrêtent les organisateurs du génocide. L’échec de ces démarches convainc l’association de quitter les camps entre 1994 et 1995 pour ne pas être « complice des auteurs du génocide27 » auxquels elle a appelé à faire la guerre.
Un an plus tard, les camps du Zaïre sont attaqués les uns après les autres par l’armée du nouveau régime rwandais et ses alliés congolais. Revenue dans la région en novembre 1996, MSF appelle, pour la seconde fois, à une intervention internationale armée pour « protéger les réfugiés et garantir l’accès à l’aide ». L’intervention n’a pas lieu, les États occidentaux arguant du retour d’un grand nombre de réfugiés au Rwanda pour décréter la fin de la crise. Plusieurs centaines de milliers de Rwandais ont pourtant refusé de regagner leur pays. Ils sont impitoyablement pourchassés par l’armée rwandaise et ses alliés congolais, qui utilisent les organisations humanitaires comme appât pour attirer les personnes en fuite, non pour les déporter comme en Éthiopie, mais pour les éliminer physiquement. Pendant toute l’année 1997, MSF dénonce publiquement les massacres et les violations des droits humains dont ses équipes ont connaissance, sans parvenir réellement à susciter d’initiatives permettant de s’opposer aux tueurs.
En 1997, rappelant que MSF a tout essayé pour tenter « d’humaniser l’inhumain », le président de la section française constate les limites de l’action humanitaire face aux violences extrêmes : « Nous avons essayé de faire le moins de mal possible28. » Dès le milieu des années 1990, l’euphorie postguerre froide nourrissant l’espoir d’un « nouvel ordre mondial fondé sur les droits de l’homme29 » fait place à une prudence teintée d’amertume. « Attention à la vision mégalomaniaque qui prétendrait universaliser le combat pour la justice et la démocratie et tomber dans la vision onusienne d’un bien-être universellement partagé », déclare Philippe Biberson lors de l’assemblée générale de 1996. MSF-France amorce un recentrage de ses prises de position publiques sur les politiques d’assistance et prend ses distances vis-à-vis de l’interventionnisme libéral confiant à l’ONU, appuyée par les démocraties occidentales, la responsabilité de garantir le respect des droits humains à l’échelle de la planète.
Lire la troisième partie les années 2000.


