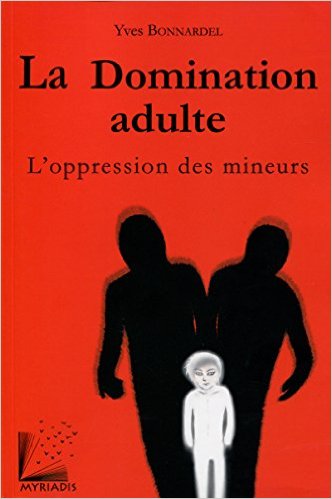
La domination adulte… Qu’est-ce que ça veut dire ? Les adultes aident les jeunes de l’espèce, qui ne pourraient pas vivre seuls, les nourrissent, les élèvent, bref, sont leurs bienfaiteurs … Domination ? Mais de quoi parlez-vous ?
Eh bien on parle en effet d’une domination, et même d’une appropriation de la partie jeune de la population, par la population adulte.
Revenons en arrière. La familia romaine, ce n’était pas notre famille contemporaine, mais celle-ci est l’héritière de celle-là. La familia désigne l’ensemble des parents adultes, des enfants, des domestiques et des esclaves possédés par le pater familias. Il a droit de vie et de mort sur les membres de sa familia. Son épouse fait partie de cette familia. Le travail de tous les membres de la familia est dû au pater familias.
Que reste-t-il dans la famille actuelle de cette familia ? Il reste que les femmes ont mis des siècles – et des luttes – à récupérer leur force de travail pour elles-mêmes, à pouvoir la vendre et être rémunérées. Et jusqu’en 1907 elles ne pouvaient pas garder pour elles cette rémunération (en France). Jusqu’en 1965, un mari pouvait s’opposer à ce que sa femme travaille « au dehors ». Jusqu’à la même date, une femme mariée ne pouvait pas ouvrir un compte en banque séparé sans l’autorisation de son mari.
L’appropriation du travail des femmes dans notre société – occidentale, européenne, française – demeure dans le travail dit « ménager », dont les femmes font largement plus que leur part (80%), et dans le travail para-professionnel des épouses de travailleurs indépendants. Qui sont considérés comme seuls. Récemment, en une semaine, deux émissions concernant le travail agricole montraient un homme seul. Dans l’une on voyait une femme en arrière-plan, en train de remuer du fourrage à la fourche. Dans l’autre, on ne voyait pas de femme du tout, mais le journaliste disait que l’agriculteur « travaillait seul », avec « seulement l’aide de sa femme ». Et l’agriculteur disait qu’il avait une « famille à nourrir ». Incluant donc sa femme dans les personnes dépendantes. Dépendantes ou « aidantes » ?
Dans la logique du mode de production domestique – ou familial, ou patriarcal – c’est tout un. Car en effet, cette famille dépend de lui. C’est lui qui vend le blé ou les vaches produites par le travail familial sur le marché, c’est lui qui encaisse l’argent, et décide de sa disposition. On dira : mais aujourd’hui les couples discutent… Certes ils discutent, mais le pouvoir de négociation de la femme est infiniment plus faible que celui du mari quand ils ne sont pas formellement associés, et que lui seul est l’interlocuteur officiel de la chambre d’agriculture, du fisc, du syndicat. Si les lois permettent aujourd’hui que femme et mari s’associent, ce qui n’était pas le cas jusqu’au milieu du vingtième siècle, elles sont rarement utilisées, et quand elles le sont, elles ne garantissent toujours pas aux femmes une charge de travail équitable, un pouvoir équitable, et une retraite équitable.
Et les enfants ? Jusqu’au vingtième siècle, les enfants, comme les femmes, comme les frères cadets et les sœurs célibataires vivant dans la famille, étaient une force de travail gratuite pour le chef de famille. Qu’il utilisait comme il voulait. Souvent en « plaçant » ses enfants comme domestiques chez d’autres agriculteurs ou artisans ou bourgeois, qui lui versaient le salaire de la fille ou du fils.
Aujourd’hui, ceci scandaliserait, dans les pays occidentaux. « Pourquoi ces enfants ne sont-ils pas à l’école ? » demandent régulièrement des journalistes français dans des reportages sur l’Inde ou l’Ethiopie, sans se demander si, pour commencer, il y a des écoles. Il n’y a souvent pas d’écoles, ou pas assez, ou trop loin. Mais surtout, les pères ne veulent pas se priver de la main d’œuvre de leurs enfants. Le système qui était majoritaire il y a seulement 100 ans dans une Europe essentiellement rurale, est le système qui est le plus répandu dans le monde, un monde où 80% de la population vit de l’agriculture et où prédomine le mode de production domestique.
C’est un mode de production qui ne se limite pas à notre « famille conjugale », mais concerne une famille élargie beaucoup plus grande, et qui fixe, à chaque échelon de parenté avec le chef, les devoirs et les privilèges. Les droits humains, fondés sur la notion de personne, ne peuvent exister car les individus ne sont pas, par définition, égaux entre eux, mais au contraire définis par leur inégalité même : à un degré de parenté du chef de famille, à deux, à trois, etc. Et de plus, femmes ou hommes. Et enfants ou adultes. Et libres ou esclaves.
Le statut d’enfant – le statut de « mineur » – est, y compris dans nos sociétés « développées », un statut d’infériorité sociale générale, d’incapacité légale, de subordination, et d’appropriation. On le voit bien dans les cas de divorce, la question est : à qui appartiennent les enfants ? Les enfants sont des propriétés.
Yves Bonnardel s’attaque à cela, en déconstruisant la discrimination fondée sur l’âge, qui repose sur l’idée que certaines capacités sont nécessaires pour disposer de soi – pour être propriétaire de soi. Peut-être : mais alors, pourquoi ne pas les définir, et puis les mesurer ? Au lieu d’estimer que l’âge en est un indicateur suffisant ? Alors que nous savons toutes et tous qu’il n’en est rien ?
Mais d’abord, il a essayé de restituer la condition d’enfant « non pas telle que la présentent les adultes, mais autant que possible telle qu’elle émerge des paroles des mineurs ». Dans ces paroles, il trouve la confirmation que la domination adulte est marquée au sceau de la violence et de la contrainte. « Le statut de mineur consiste en rien moins que l’imposition d’une famille, d’une école, et au-delà, d’une éducation ». Que les enfants aient la liberté d’acquérir des connaissances, oui : elles/ils en sont demandeurs, elles/ils sont pleins de questions sur le monde. Mais cette curiosité est vite étouffée par nos systèmes scolaires punitifs et abrutissants, qui les détournent en quelques années de leur soif de savoirs. Pourtant, des alternatives existent : j’ai bénéficié, par la « chance » d’une maladie, d’un an d’école Freinet, un an de bonheur et d’accès libre à tout ce que j’avais envie de connaître. Tout était à ma disposition, et rien n’était obligé.
Mais notre éducation continue d’être marquée par la croyance chrétienne que nous naissons habités par le diable, et qu’il faut le faire sortir de nos corps à coups de coups et de punitions, qu’il faut nous « mater » dès le plus jeune âge [1].
Dans toutes les sociétés connues, les enfants sont les possessions de leurs « parents » – quelle que soit la façon dont ceux-ci sont désignés. Les dispositifs consacrés en Occident à la protection de l’enfance, quand on regarde de près leur action dans les cas de violence avérés, sont en réalité là pour réaffirmer le droit supérieur des parents. Les enfants, les jeunes de notre société, sont livrés, sans contrôle de la communauté, à l’arbitraire d’un ou deux individus. On pense que les agressions sexuelles sur les enfants, qui sont en majorité le fait des parents – enfin, surtout des pères ou des oncles et grand-pères – sont dues aux particularités psychologiques des agresseurs. Mais ces agresseurs sont en réalité « Monsieur-tout-le-monde ». En fait ils sont dus à ce que les mineurs n’ont pas le droit de disposer d’eux-mêmes. On découvre maintenant que l’inceste est fréquent : mais il l’a toujours été. Simplement, avant, il existait un consensus pour ne pas en parler, pour faire comme si cela n’existait pas, alors qu’en fait, c’était tout simplement permis, à condition de ne pas le révéler. Si fréquent que Freud a renoncé à en parler, et en toute connaissance de cause, l’a maquillé en « fantasme » des victimes.
Il en va de même des autres violences [2]. Récemment, quand une députée a proposé en France que les parents n’aient plus le droit de gifler ou de fesser leurs enfants, sa phrase a été accueillie dans l’Assemblée nationale par des éclats de rire. Or il est question d’actes qui sont des délits… quand ils sont commis par un adulte sur un autre adulte. L’idée que la même règle s’applique quand ils sont commis par un adulte sur un individu plus petit, plus faible, et dépendant : il y a bien de quoi s’esclaffer !
Oui, dépendant : quel que soit l’éventuel travail fourni par un enfant au bénéfice de ses parents, il est censé être « entretenu » par ceux-ci. Et en théorie, les enfants ont des droits dans nos sociétés. Mais qui va les faire appliquer quand l’agresseur est aussi le représentant légal de « son » enfant, celui qui pourrait porter plainte, alors que l’agressé, parce qu’il est mineur, ne le peut pas ? Le père incestueux, la mère violente, vont-ils au nom de leur enfant, porter plainte contre eux-mêmes ?
L’absence de personnalité juridique des enfants, leur grande solitude, leur vulnérabilité légalement organisée, voilà aussi l’une des pierres de touche, sinon la pierre de touche, du statut de mineur – qui est un statut de non-personne.
Cette même absence de personnalité juridique fait que les enfants ne peuvent pas travailler hors de la famille, contre rémunération. On dira : mais on ne veut pas qu’ils travaillent ! Peut-être est-ce mieux qu’ils n’aient pas à travailler, mais est-ce juste qu’ils n’en aient pas le droit ? Est-ce juste qu’ils n’aient pas un accès personnel à des ressources, à des possibilités d’indépendance ?
Si vraiment ils sont si bien traités par leurs familles, alors ils choisiront d’y rester. Mais ils doivent avoir la possibilité d’en partir ; et de toutes façons, de ne pas être seulement des esclaves, même choyés.
Cette question se pose surtout à propos des pays « en voie de développement » où deux sortes de travail des enfants co-existent : l’une est un travail pour le père de famille, mais l’autre est un travail pour soi ; soit que ces enfants n’aient pas de famille, soit qu’ils aient décidé de vivre indépendamment pour diverses raisons. Or les critiques occidentales sur ces enfants qui « ne sont pas à l’école » confondent allègrement les deux cas.
Et dans le deuxième cas, cette possibilité de travailler doit être ouverte aux enfants dans nos pays aussi. Yves Bonnardel note avec raison que les mineurs pourraient, comme les autres, avoir accès à des ressources pour vivre, même sans travailler ; si les conditions de production mais surtout de redistribution des richesses, régies par le capitalisme et le patriarcat, étaient différentes.
Ce livre est important, parce qu’il met en cause non seulement le statut de mineur, mais du coup aussi son autre complémentaire, le statut de majeur : ce livre, dit Bonnardel, est « un plaidoyer pour l’égalité enfants-adultes ». Et cette proposition fait partie, pour lui, d’un projet plus large, contre « les dominations qui fondent notre monde commun et qui sont des rapports de pouvoir structurels qui empêchent tout un chacun de déployer et d’offrir véritablement toute sa richesse, son inventivité, sa fantaisie, son individualité, sa liberté, son amour et sa joie ». Un projet utopique ? Certes : mais n’est-ce pas ainsi que commencent tous les projets politiques ?


