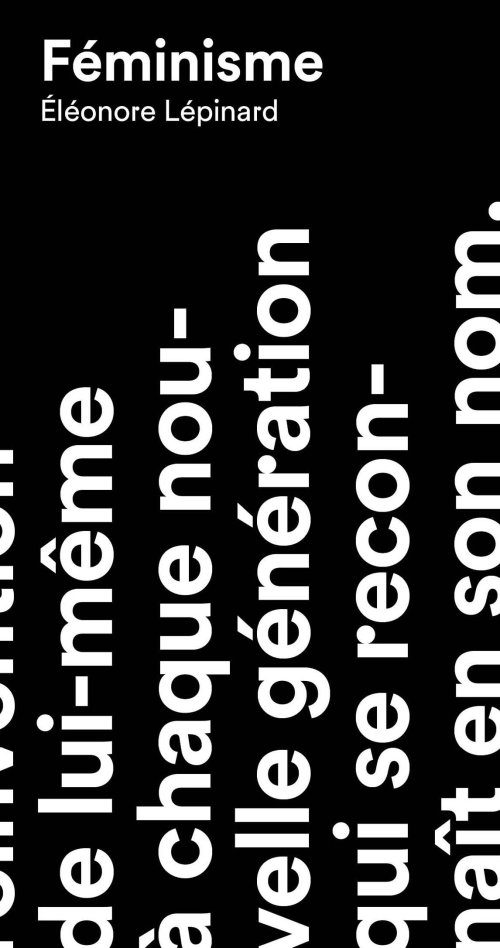Un mot dangereux pour certain·es, car accusé d’être porteur d’excès et de débordements. Excès d’une demande d’égalité qui risque fort de renverser l’ordre établi : les hommes deviendraient les dominés et les victimes d’une société qui aurait finalement laissé les femmes prendre trop de pouvoir. On pense par exemple à l’inquiétude récurrente depuis trois décennies concernant la réussite scolaire des garçons, inférieure à celle des filles, ou à la crainte des signataires de la tribune sur « la liberté d’importuner » de voir des hommes innocents condamnés par le tribunal populaire de #metoo. Excès du désir de rendre acceptables et légitimes de nouvelles identités, en dehors de la binarité hommes/femmes et en dehors de l’hétérosexualité. La « manif pour tous » a ainsi agité le spectre d’un renversement des rôles de genre – petits garçons éduqués comme des petites filles et vice-versa – que ne manquerait pas d’amener l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe.
Débordement dans les mots eux-mêmes où de nouvelles lettres et de nouvelles ponctuations viennent déranger l’ordonnancement auquel nous étions habitué·e·x·s – allons-nous seulement pouvoir continuer à nous comprendre ? Excès d’une exigence d’adopter de nouvelles façons de se comporter les un·e·s avec les autres, d’utiliser un nouveau langage pour dire les choses : agressions sexuelles plutôt que séduction, inégalité plutôt que complémentarité, droit plutôt que faveur, hétéronormativité socialement instituée plutôt que nature éternelle, non-binarité, intersexuation et transidentité plutôt que pathologie.
L’antiféminisme, à chaque époque, n’est donc pas en reste de mises en garde sur les conséquences catastrophiques qui ne manqueraient pas d’arriver avec l’adoption de nouveaux droits pour les femmes – le terme femmes recouvre dans l’ensemble de ce texte les femmes cis, pour lesquelles le genre d’identification et le genre d’assignation à la naissance sont similaires, et les femmes trans. J’utilise également le féminin universel pour me référer au(x) sujet(s) féministe(s). Droit de vote et avortement : ces droits arrachés de haute lutte ont été combattus farouchement au titre qu’ils menaçaient de faire s’écrouler tout l’ordre social, de diviser les familles, de tuer des innocents.
Face à ces désordres annoncés, l’antiféminisme propose toujours les mêmes recettes : revenir à une époque antérieure perçue comme harmonieuse car définissant et restreignant les rôles des unes et des autres, et établissant des relations hiérarchiques claires, sans ambivalences, aussi bien au sein de la famille que de la société. La décision Dobbs de la Cour suprême américaine de 2022 défaisant l’Arrêt Roe v. Wade de 1973 qui avait garanti le droit fédéral à l’avortement pendant presque cinquante ans l’illustre avec une cruauté particulière.
Autre stratégie de l’antiféminisme : la suppression épistémique. L’antiféminisme s’attaque aux institutions éducatives, à la production et à la transmission des savoirs porteurs d’égalité. En 1801, Sylvain Maréchal, écrivain et révolutionnaire français, propose, comme le rappelle Geneviève Fraisse dans son ouvrage Muse de la raison, un projet de loi interdisant aux femmes d’apprendre à lire. En 2014, les mobilisations – victorieuses – contre les « ABCD de l’égalité » dans les écoles primaires publiques ont réussi à interdire en France des matériels pédagogiques pour parler aux enfants du genre et des inégalités. Depuis #metoo, les attaques contre les études de genre se sont multipliées, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Sur plus de deux siècles se dessine une ligne claire : celle de la censure, de l’interdiction d’interroger nos certitudes. Une ligne de résistance et d’attaques farouches contre le féminisme et contre la liberté dont il est porteur.
Attention danger aussi, car, oui, le féminisme brûle ! Des « pétroleuses » incendiaires de la Commune de Paris, aux soutiens-gorges que les féministes du Mouvement de libération des femmes (MLF) auraient soi-disant brûlés : ces mythes tenaces associent dans notre imaginaire collectif les féministes avec un feu ravageur. L’incandescence de ce mot est aujourd’hui ravivée de mille feux, à coups de hashtags, de témoignages et de colères enfin rendues publiques, à coups de cortèges hurlants qui déferlent dans les rues, à coups de slogans exhumés d’une autre époque brûlante elle aussi, celles des années 1970, et à coups de chorégraphies à dimension planétaire qui désignent sans détour l’ennemi :
« un violador en tu camino, el violador, eres tu » ! [1].
C’est un feu, un feu de joie qui éclaire des futurs possibles, des désirs d’émancipation qui prennent forme là où il n’y avait qu’une réalité sans nom, un malaise indicible, une expérience de marginalisation, d’exploitation, d’invisibilisation qui restait sans langage pour se dire. Que les slogans proviennent de l’Europe, des États-Unis, de l’Iran, du monde arabe ou du sous-continent indien, les mots défilent, se dispersent, se diffusent, pour clamer cette aspiration : « Femme, Vie, Liberté ».