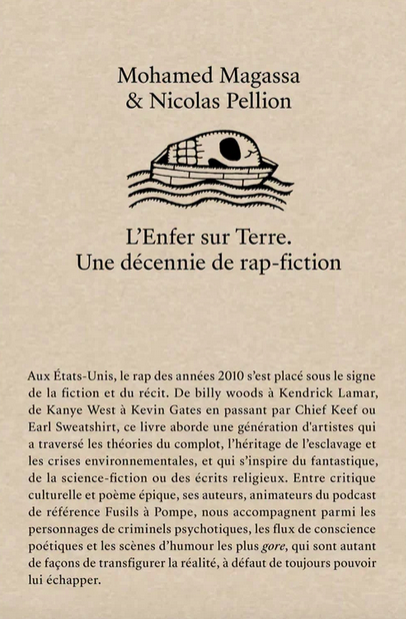La terre des champs de bataille de Gettysburg et de Chancellorsville, déjà battue par le galop des montures, fendue par les roues des canons et tabassée par les courses et les chutes des fantassins, a fini par s’ouvrir en deux, laissant échapper une nuée de cadavres revenus d’outre-tombe.
Une marche des morts a mis un terme à la guerre civile opposant le gouvernement fédéral aux États confédérés, et la nouvelle Amérique née de cette invasion s’organise autour de la sécurité d’une partie restreinte de la population. La loi de rééducation exige que les natifs américains et les anciens esclaves rejoignent des écoles de combat, pour s’entraîner à la lutte contre les morts-vivants. Pour les jeunes femmes noires comme Jane McKeene, l’entrée dans ces écoles est vue comme une opportunité. Elle y étudie l’art de la défense et du combat, mais elle y est aussi instruite et familiarisée à l’étiquette et à la culture des riches familles blanches du Sud.
À travers l’uchronie zombie de Dread Nation, Justina Ireland développe une réflexion sur les discours qui mettent bruyamment en avant certains acquis prétendus, comme pour mieux faire obstacle aux batailles qu’il reste à mener. Dread Nation est un livre sur le rêve américain et sur la façon dont ce rêve n’existe vraiment que pour un petit sous-ensemble du pays. Il s’agit de savoir qui peut revendiquer son humanité et qui est considéré comme un simple moyen au service d’objectifs que d’autres se sont fixés. Il s’agit d’aimer un endroit qui ne vous aimera pas en retour, peu importe à quel point vous êtes prêt à saigner ou à mourir pour lui. Il s’agit de comprendre que, peut-être, les choses que l’on nous dit et les choses auxquelles d’autres croient ne suffiront pas à assurer votre sécurité. Car même libérées de l’esclavage, les femmes noires de Dread Nation restent sacrifiables.
Chair à canon
Megan Jovon Ruth Peeth, née à San Antonio au Texas, a elle aussi étudié l’art de la défense et du combat. Elle aussi s’est instruite et familiarisée à l’étiquette et à la riche culture des états du Sud, et elle a été choisie pour défendre leur héritage. Son histoire ressemble à celle des héroïnes de Justina Ireland. C’est l’histoire de Megan Thee Stallion.
Megan Thee Stallion aurait pu finir comme beaucoup d’autres artistes texans et texanes. Son agresseur, le chanteur canadien Tory Lanez, lui a tiré dessus à quatre reprises, la blessant par deux fois au pied. Cette affaire, avec l’ensemble des remous qui l’ont accompagnée, a fait apparaitre aux yeux de tous des choses que pour sa part, Megan n’avait jamais ignorées : certains corps, parce qu’ils sont noirs, parce qu’ils sont féminins, comptent pour peu de chose. Pour preuve, au lendemain de son agression, l’industrie, par la voix d’artistes de premier plan, de journalistes, de blogueurs à scandale, ne la soutiennent pas elle, mais préfèrent défendre Tory Lanez, qu’elle présente comme victime d’une cabale.
En retournant en sa faveur, comme elle a toujours su le faire, les fantômes libérés par ces coups de feu, Megan Thee Stallion écrit Traumazine, de loin son album le plus personnel, et le plus proche des promesses qui faisaient d’elle l’héritière de toute une histoire du rap sudiste. En fil rouge, on y trouve le mépris, le harcèlement, la déshumanisation, les trahisons, qui jalonnent son parcours et celui des nombreuses femmes en qui elle se retrouve : Marilyn Monroe, Britney Spears, Whitney Houston, et toutes celles que l’industrie du divertissement a écrasées. Pour Megan Thee Stallion, protéger sa propre santé mentale passe par la célébration d’un corps à la fois armure et étendard, et dont chaque aspect, des formes aux cheveux, de la couleur à la taille, est une source intarissable de fierté.
Après avoir jonglé entre divers alter egos sur ses précédents albums et mixtapes, Meg promet d’être elle-même. Le but est explicitement de reprendre le contrôle de son histoire et de son identité, spoliées par son entourage. Elle entame d’ailleurs, au moment de la sortie de Traumazine, un procès contre le label 1501 Certified, estimant que le contrat signé ensemble n’est pas respecté. Sa colère s’entend à la manière dont son flow frappe les dernières syllabes de chaque phrase comme le coup de fouet d’une dresseuse de fauves. Cette manière acerbe de rapper, adoptée par les rappeurs pimps de Memphis jusqu’à Houston depuis les années 1990, est un moyen de dominer ses adversaires, de s’imposer par la rage et la technique. À travers Megan et son flow qui parcourent des productions inspirées de traditions venues des quatre coins de l’Amérique, c’est aussi un récit de l’histoire des femmes dans le rap qui s’écrit, où l’on croise autant Queen Latifah et Lil Kim, que Trina et Nicki Minaj.
Au terme de l’album, on trouve « Southside Royalty Freestyle », co-produit par Juicy J de Memphis et Mr. Lee de Houston, avec un sample des Isley Brothers, comme l’affectionnaient autant UGK au Texas que Three 6 Mafia dans le Tennessee. Sur ce remake de « So Real », titre mythique de sa région d’origine, elle invite Sauce Walka, Big Pokey et Lil’ Keke. Soudain, ce qui était pourtant explicite devient évident. Megan a traversé cet album avec ses fantômes, mais parmi eux se trouvaient quelques belles âmes du Sud. Son aplomb sent les molards que lançait le regretté Pimp C à la face du rap, son charisme insolent rappelle aux bons souvenirs de Gangsta Boo – qu’elle repose en paix.
Quelques années plus tard, la justice rend son verdict dans l’affaire opposant Megan à Tory Lanez. Dix ans de prison sont requis à l’encontre de Lanez. L’accusé se défend une dernière fois publiquement, dans un long post Instagram clamant son innocence. Parmi les centaines de milliers de like, on trouve encore aujourd’hui celui de Drake.